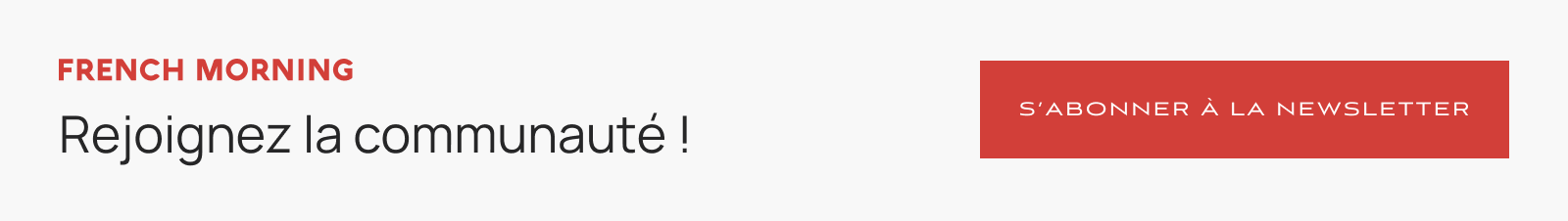Le Metropolitan Museum de New York propose dès le 15 février, une rétrospective exceptionnelle consacrée à la portraitiste du XVIIIe siècle.
« Vigée Le Brun : Woman Artist in Revolutionary France » est la toute première rétrospective accordée à l’artiste française. Le Metropolitan Museum a réussi à réunir 80 œuvres. Les tableaux viennent d’Europe et des États-Unis, de collections publiques et privées. L’exposition est à découvrir jusqu’au dimanche 15 mai.
Elisabeth Louise Vigée Le Brun est née à Paris pendant le règne de Louis XV. Fille d’un portraitiste professionnel, elle s’intéresse très jeune à l’art, mais à l’époque, les Académies n’étaient pas accessibles aux femmes. Les élèves y étudiaient l’anatomie et apprenaient les bases de la peinture en dessinant à partir de modèles masculins nus. Vigée Le Brun était donc une autodidacte et a commencé à travailler à son compte en tant que portraitiste. Son travail est exposée publiquement pour la première fois au Salon de l’Académie de Saint-Luc alors qu’elle n’a que 19 ans. Quatre ans plus tard, l’artiste commence à travailler pour la reine Marie-Antoinette, qui deviendra l’un de ses modèles récurrents.

Pendant la Révolution, Élisabeth Louise Vigée Le Brun est obligée de fuir la France à cause de ses liens avec la reine Marie-Antoinette. Elle se réfugie en Italie, mais continue son travail de peintre en voyageant à travers l’Europe, en Autriche et en Russie notamment, pour tirer le portrait de différents aristocrates. La portraitiste des monarques revient pour de bon en France en 1805 et meurt en 1842 après avoir connu un long succès. Elle est ainsi devenue une artiste féminine importante pendant l’une des périodes les plus troubles de l’Histoire de France.
Ouverture de la retrospective exceptionnelle sur Vigée Le Brun au Met
Français des Etats-Unis, ils sont privés de compte bancaire en France
La première fois que Paul Mode, retraité français du New Jersey, a croisé le chemin de la loi FATCA, c’était dans un courrier envoyé en mai 2015 par sa petite banque Tarneaud à Saint-Junien (Haute-Vienne). L’établissement bancaire l’informait que le compte qu’il y détenait depuis quarante ans allait être fermé “dans un délai légal de 60 jours” à cause de cette mystérieuse loi bancaire américaine.
Surpris, et déterminé de ne pas voir fermer ce compte sur lequel il percevait sa retraite, Paul Mode a pris son bâton de pélerin. En juillet, il a fait valoir son “droit au compte” auprès de la Banque de France. Ce droit peu connu permet à un Français en France ou à l’étranger qui ne possède pas de compte de dépôt d’en faire ouvrir un. L’institution lui recommande dans un premier temps de contacter plusieurs banques en ligne. En vain. En septembre, conformément à la procédure, la Banque de France désigne une banque – en l’occurence BNP Paribas – pour l’ouverture du compte de M. Mode. Au terme d’une communication difficile, la banque exige de Paul Mode qu’il se présente en personne dans une agence parisienne pour procéder à l’ouverture. Chose que cet ancien ingénieur mécanicien de 77 ans, sans attache en France, ne veut pas faire. “Je n’ai pas abandonné, mais je ne vais pas faire un voyage spécialement pour ça. On va certainement me trouver des excuses pour ne pas m’ouvrir le compte, regrette-t-il, un brin dépité. Heureusement, j’ai réussi à tout faire transférer à Bank of America” .
A l’origine du calvaire bancaire de Paul Mode: les craintes de plusieurs banques en France de se retrouver en violation de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), une loi obscure votée en 2010 par le Congrès américain pour lutter contre l’évasion fiscale. La loi impose notamment aux banques étrangères de rapporter à l’administration fiscale américaine les informations bancaires de leurs clients présentant des “indices d’américanité” (visa américain, carte verte, résidence aux Etats-Unis, binationaux…). Seuls les comptes ayant un solde supérieur à 50.000 dollars sont visés par la loi. On estime que 50.000 comptes sont concernés en France. Les banques qui ne transmettent pas les informations de leurs clients risquent une pénalité financière.
Alerté dès février 2014 de la multiplication des fermetures de comptes par le député des Français d’Amérique du Nord Frédéric Lefebvre, le gouvernement a répondu que “les gros établissements, ceux qui ont suffisamment de clients, n’ont pas pris ce chemin” . Or, la Société Générale, Axa, Natixis ou ING – des établissements pointés du doigt – ne sont pas de petites banques. Et les notifications de clôtures continuent d’être envoyées, plus d’un an après l’entrée en vigueur de la loi en France le 1er juillet 2014. “FATCA a été votée pour lutter contre l’exil fiscal, mais des petites gens se retrouvent pénalisées, résume Damien Regnard, conseiller consulaire qui a tenu une réunion sur le sujet en novembre à Houston. Pour les banques, la mise en conformité représente un coût important. Elles en profitent pour se débarrasser des clients avec des comptes modestes, peu crédités. On assiste à des limitation d’accès, des limitations d’opérations… Les gens ne comprennent pas que la banque ait le droit de fermer leur compte sans avoir à se justifier” .
Parmi les personnes concernées, les “Américains accidentels”, nés aux Etats-Unis de parents étrangers et qui ont vécu une courte période sur le sol américain. Mais aussi les citoyens américains devenus Français, comme Christophe Hancock, enseignant d’anglais en Guyane française. Né à Washington et “naturalisé français depuis 22 ans” , il a tenté d’ouvrir un compte en ligne sur ING Direct, mais la banque a ouvertement répondu à ses clients sur son forum que “ING a décidé que, pour des raisons économiques, l’ensemble des entités du Groupe à l’extérieur des États-Unis ne pourraient pas mettre en place les procédures spécifiques” pour les “US Persons qui souhaitent ouvrir un ou des produits d’investissement en dehors des États-Unis.”
Les clients comme Christophe Hancock, qui présentaient “des indices d’américanité” , ont dû se résoudre: ils ne pourraient pas ouvrir de compte en ligne, ni de compte courant, ni d’assurance vie ou de portefeuille d’actions. “Je travaille en France. Tous mes revenus sont en France. Mes enfants sont en France. Je ne gagne que des euros. Je ne vois pas pourquoi je devrais me déclarer auprès du fisc américain, confie-t-il. Comme j’avais un “indice d’américanité”, j’ai été exclu. Nous ne sommes pas considérés comme des clients de première catégorie, alors que nous sommes des clients à part entière. J’aurais dû me renseigner avant de faire ces démarches. Je n’avais aucune idée que FATCA existait. C’était une mauvaise surprise” .
“La France se couche”
Les comptes de dépôt ne sont pas seuls à souffrir. Denise Berthier, 87 ans, résidente permanente aux Etats-Unis depuis trente ans, avait un portefeuille de titres à la Société générale, banque dont elle est cliente depuis “trente ans, et mes parents depuis 1928” . Il y a six mois, elle a reçu un courrier l’informant que son portefeuille ne serait plus géré par la banque. Elle est aujourd’hui en négociation pour le transfert de ses titres. “La France n’est plus souveraine sur ses nationaux lorsqu’ils sont aux Etats-Unis. On se couche. Ca ne serait pas arrivé du temps du Général de Gaulle! s’exclame-t-elle. Je reçois la pension de mon mari sur un compte en France. Je n’ai pas envie qu’on le ferme. J’ai un appartement qui se loue à Paris et j’ai un compte qui ne sert qu’à ça. Je veux pouvoir aller dîner avec des amis en France, retirer de l’argent. C’est le droit normal de tout citoyen. ”
Même son de cloche chez Patrick Pagni, Français de New York, chairman de la firme de gestion d’actifs Amundi Smith Breeden. Lui aussi tente de rapatrier son portefeuille aux Etats-Unis après avoir frappé à la porte de BForBank (Crédit agricole) et Boursorama. “Vous ne pouvez pas aller ailleurs en Europe. Personne ne veut de vous. Je suis toujours citoyen français, j’ai une carte verte. En matière bancaire, la France me demande d’aller ailleurs. Un citoyen français ne peut plus être traité par la France. Les Etats-Unis nous imposent quelque chose et nous ne résistons pas, regrette-t-il – M. Pagni est membre de l’antenne new-yorkaise Les Républicains. Il y a 200.000 Français aux Etats-Unis. Moins de 10% doivent avoir un portefeuille de titres. Cela n’intéresse que très peu de gens. ”
Poursuite judiciaire
Aucune des banques françaises citées dans cet article n’a répondu à notre demande de commentaire. Seule la banque de France a indiqué que les clients qui voulaient se voir ouvrir un compte courant en France “doivent se présenter physiquement en agence. Le modèle est ainsi” . Elle souligne que la Banque de France n’a “pas eu beaucoup de cas de saisines” pour faire valoir le droit au compte, peut-être par méconnaissance de ce droit.
“La loi du droit au compte n’est pas faite pour les Français à l’étranger, mais c’est un problème mineur pour le gouvernement aujourd’hui” , regrette Paul Mode, du New Jersey. “Pour arrêter quelques trafics avec FATCA et attraper une personne sur cent, ils vont en embêter 99. Pour nous, c’était quand même pratique d’avoir un compte en France pour les paiements à la famille par exemple.”
Aux Etats-Unis, FATCA aussi provoque des remous. En juillet 2015, le Sénateur Rand Paul, ex-candidat à la primaire républicaine, et d’autres ont déposé une plainte contre l’administration Obama au motif que la loi FATCA est inconstitutionnelle et qu’elle entraine de nombreux expatriés américains à renoncer à leur nationalité en raison de difficultés d’accès à certains services bancaires. En 2015, 4.279 renonciations ont été enregistrées selon le Département du Trésor américain. Un record. Raison principale, selon la BBC: FATCA.
Anne-Claire Legendre nommée consule à New York
C’est officiel. La nomination d’Anne-Claire Legendre au poste de consule de France à New York est parue au Journal Officiel.
“Par décret du Président de la République en date du 10 février 2016, Mme Anne-Claire Legendre, conseillère des affaires étrangères, est nommée consule générale de France à New York, en remplacement de M. Bertrand Lortholary, appelé à d’autres fonctions” peut-on lire dans le JO daté du 11 février.
Il n’est pas clair quand l’entrée en fonction de Mme Legendre interviendra ni quelles seront les futures fonctions de M. Lortholary, arrivé cette année au terme normal de son mandat. Il pourrait être nommé ambassadeur, rang qu’il avait brièvement occupé en Indonésie avant que sa nomination ne soit annulée par le Conseil d’Etat.
Anne-Claire Legendre, ex-conseillère Afrique du Nord Moyen-Orient de Laurent Fabius, devient ainsi la deuxième consule de France sur le sol américain avec Pauline Carmona arrivée en 2014 à San Francisco.
Décrite comme une “jeune et brillante diplomate” par l’Obs, elle est arrivée au sein du cabinet de Laurent Fabius en 2013 après avoir été conseillère au Conseil de sécurité des Nations Unies (Syrie, Israël-Palestine, Liban, Irak) au sein de la mission française, sous l’autorité de l’actuel Ambassadeur de France aux Etats-Unis Gérard Araud.
Elle a aussi occupé un poste d’attachée de presse à l’Ambassade de France au Yémen, avant de devenir chargée de mission pour les affaires européennes auprès du Directeur des Français de l’Etranger, où elle était en charge d’améliorer les possibilités de coopération avec les Etats membres de l’Union européenne dans le domaine des affaires consulaires.
Pourquoi un métro en chiffres et en lettres à New York ?
Si vous prenez le métro à New York, vous avez sûrement remarqué que certaines lignes sont désignées par des lettres et d’autres par des chiffres. Une originalité qui en a déjà dérouté plus d’un (usager, pas métro). Pourquoi le réseau des transports en commun a-t-il décidé de jouer à “Des chiffres et des lettres” ? C’est la question bête de la semaine.
Pour répondre à cette question, Clifton Hood, professeur d’Histoire à Hobart and William Smith Colleges à Geneva (New York) et auteur du livre 722 Miles: The Building of the Subways and How They Transformed New York City nous fait remonter un peu dans l’Histoire, à l’année 1860 plus précisément. « À l’époque, la ville de New York est complètement congestionnée, les rues sont bondées et les ferries qui relient les différentes îles sont plein à ras bord. L’administration de la ville a donc décidé de moderniser son réseau en s’appuyant sur un système de transport souterrain : le fameux subway ».
Le transport métropolitain existait déjà à Londres, à Paris, à Budapest ou encore à Athènes, mais aucune ligne n’avait encore été ouverte sur le continent américain. « La ville de New York ne voulait pas s’engager seule dans ce projet. Elle avait peur d’être accusée de mener une politique trop socialiste si elle se lançait dans ce programme de construction d’un nouveau réseau de transports en commun. L’administration a donc préféré opter pour un partenariat public/privé » explique l’historien.
Le projet a cependant eu du mal à attirer les investisseurs. Les compagnies privées ne voulaient pas s’engager dans un chantier aussi onéreux sans garantie de rentabilité. La ville de New York doit alors faire des concessions, elle finança elle même la construction des lignes, mais confia à l’Interborough Rapid Transit Company (IRTC) la gestion du réseau. La première ligne vit le jour en 1904. En parallèle, la Brooklyn Rapid Transit Company (elle sera ensuite rebaptisée Brooklyn-Manhattan Transit Corporation) qui avait déjà un réseau de train aérien à Brooklyn décida d’enterrer une partie de ses lignes dès 1908.
Deux compagnies se partageaient donc le marché du transport souterrain à New York. La IRTC baptisa ses lignes avec des lettres tandis que la BMT avec des chiffres.
Pour compliquer encore plus le système, un troisième acteur entra lui aussi dans la course. La ville de New York décida, en 1920, de lancer sa propre compagnie de transport souterrain : l’Independent Subway System (IND) et nomme, elle aussi, ses lignes avec des lettres. On arrive donc à trois compagnies se partageant le marché et utilisant deux nomenclatures différentes.
« L’administration décida finalement d’unifier le réseau de transport à New York et racheta petit à petit les compagnies concurrentes. En 1940, l’IND devint la seule et unique entreprise de transport souterrain à New York » continue l’historien.
On peut se demander alors pourquoi ne pas avoir décidé d’unifier, aussi, le nom des lignes. Pour cette question aussi, Clifton Hood a la réponse: « Les rails des lignes chiffrées sont plus étroits que ceux des lignes lettrées, les trains peuvent donc uniquement rouler sur l’un ou l’autre système. C’est pour les distinguer qu’on continue à utiliser deux nomenclatures différentes ». Il y a donc encore officieusement deux systèmes de métro qui cohabitent à New York.
La fin du "tip" au restaurant ? Pas si vite…
Vous pensiez que 2016 sonnerait la fin du “tip” ? Rien n’est moins sûr. Malgré l’annonce de plusieurs restaurateurs américains de mettre un terme à cette pratique qui rend fous de nombreux expatriés et touristes, le “tip” reste solidement ancré dans les habitudes et pourrait le rester encore très longtemps.
Le restaurateur Danny Meyer, fondateur de Shake Shack et patron du groupe de restaurants Union Square Hospitality a relancé le mouvement. Dénonçant un “système cassé” , il a annoncé fin 2015 que le “tip” serait supprimé progressivement dans ses restaurants. Son raisonnement: grâce aux pourboires, le personnel en salle se retrouvait mieux payé que les chefs ou autres professionnels en cuisine. Il a donc décidé de compenser la suppression du “tip” par une augmentation des prix de 22 à 28%. D’autres restaurants lui ont emboité le pas. Dernier en date: le restaurant de David Chang à Chelsea Momofuku Nishi.
Le “no-tipping” , un débat ancien
Problème: ce n’est pas la première fois que cette vision “égalitariste” est invoquée pour avoir la peau du pourboire. Dans Tipping: An American Social History of Gratuities, Kerry Segrave rappelle que le tip était vu, jusqu’au début du XXeme siècle, comme une forme de pot-de-vin, incompatible avec une vision démocratique et égalitaire de la société. Puis la Prohibition a fait baisser les revenus des hôtels et des restaurants. Et les employeurs ont grandement encouragé la pratique du “tip” . Malgré le vote de lois “anti-tipping” dans plusieurs Etats dans la première partie du XXeme siècle, le “tip” a perduré. Sans doute parce que le système avantageait à la fois les employeurs et les serveurs.
Un siècle plus tard, certains restaurateurs sont farouchement opposés à la suppression du pourboire. Pour Catherine Amsellem, co-propriétaire du Parigot, elle « impactera certainement la motivation des serveurs. Un employé qui travaille en cuisine aura toujours un salaire fixe, ce qui lui procure une certaine sécurité, alors qu’un serveur est dépendant de la fréquentation du restaurant. » Elle préfère ne pas appliquer le “no-tipping” dans son restaurant en attendant que « les grands fassent leurs preuves ».
Christophe Garnier, propriétaire du restaurant Gloo, se dit admiratif de l’action de Danny Meyer mais rappelle qu’il a « l’avantage du nom, ce que les petits restaurants n’ont pas forcément ». Cette notoriété assure, en effet, à Meyer, une demande continue de la part des serveurs qui se pressent à sa porte pour avoir l’opportunité d’y travailler. Christophe Garnier va donc « scruter de très près » cette petite révolution qui n’est pas d’actualité pour son établissement.
Vanessa et Enguerrand Pacini, fondateurs d’Ange Noir Café à Bushwick sont radicaux quant à l’abolition du tip : « on est complètement contre l’initiative de Meyer. Si ça n’est pas obligatoire, on ne le fera pas ! confient-ils. Le tip est une récompense qui mesure la satisfaction du client. Les serveurs risqueraient d’aller voir ailleurs si on met en place cet effet de mode. »
Les clients aussi ne sont pas tous convaincus. Le New York Post a sorti en novembre un article sur les réactions partagées de clients au Modern, un des restaurants de Danny Meyer. Certains restaurants ayant mis en place le “no-tipping” sont revenus sur leur décision à cause de difficultés de recrutement de serveurs. D’autres, au contraire, affirment que le geste a amélioré la qualité de la nourriture et du service. C’est le cas de Jay Porter, un chef de San Diego auteur d’une tribune sur le sujet dans Slate. “Notre menu s’est amélioré, probablement parce que nos cuisiniers étaient mieux payés et se sentaient valorisés. En conséquence, notre business s’est amélioré et, en quelques mois, notre équipe de serveurs faisait plus d’argent que sous le système du tip. La qualité du service s’est améliorée aussi. A mon avis, ce n’est pas parce que les serveurs faisaient plus d’argent (même si cela a aidé). Le service s’est amélioré aussi parce que l’élimination du tip facilite la possibilité d’offrir un bon service.” Le débat est ouvert.
Testez vos connaissances sur New York au Panorama Challenge 2016
On croit tous connaitre New York avant d’avoir relevé le Panorama Challenge. Ce quizz géant, qui se déroule autour de la grande réplique de New York (ci-dessus) du Queens Museum, rassemble plusieurs équipes d’amoureux de New York. L’édition 2016 se déroulera le vendredi 4 mars, de 7 à 10pm. Les inscriptions sont ouvertes.
Le concept: un MC lit un indice en pointant son laser vers des ponts, bâtiments, territoires, parcs et autres sites new-yorkais placés sur la réplique. Les équipes d’une dizaine de membres répartis tout autour doivent se creuser la tête. La compétition comporte deux types d’équipes: les “challengers” (dont c’est la première participation et pour lesquels les questions seront plus faciles) et les “pro” (qui ont déjà participé et qui se verront poser soixante questions, contre trente pour les challengers).
Cette compétition vraiment amusante (on le sait car on l’a fait) est organisée les guides de Levy’s Unique New York. Il y a aura de la bière et des sandwiches sur place pour vous aider à vous remettre de vos émotions.
Concert de Cyrille Aimée au LFNY: offre pour nos lecteurs
Qualifiée de « doux mélange de Michael Jackson et Sarah Vaughan », par Stephen Holden du New York Times, Cyrille Aimée est une chanteuse de jazz qui décolle. Les amateurs de musique pourront la (re)découvrir le mercredi 24 février au centre culturel du Lycée français de New York. Les lecteurs du French Morning bénéficient d’une réduction sur le billet d’entrée, 20$ au lieu de 35$. Venez avec la somme le jour du concert. Et s’il n’y a plus de places, pour un billet au prix classique, c’est ici
Cyrille Aimée est originaire de Samois-sur-Seine en région parisienne. Un certain Django Reinhardt y a vécu lui aussi. C’est d’ailleurs grâce à lui, et au festival qui lui est dédié chaque année, que la chanteuse a découvert son goût pour le jazz manouche, sa spécialité.
Par la suite, cette franco-dominicaine a parcouru les scènes du monde entier, seule ou en groupe et a reçu de nombreux prix. Elle a déjà eu l’occasion de se produire à plusieurs reprises aux États-Unis depuis qu’elle s’est installée à Brooklyn.
Lycée français de Miami: le projet est "en suspens"
En mai dernier, les parents français se réjouissaient de l’ouverture à la rentrée 2016-2017 d’un Lycée Français à Miami. Aujourd’hui, Sophie Jamet et Delphine Blanchard – les initiatrices du projet avec l’entrepreneur Fabian Milon – confirment que le projet est “en suspens“, faute de fonds.
Mais ils ne désarment pas pour autant. « Nous sommes toujours persuadées du bien fondé d’un lycée français à Miami, conviction renforcée par l’important nombre de demandes d’inscriptions que nous recevons” , explique Sophie Jamet.
Avec 11.000 inscrits au Consulat de France, une présence réelle estimée à 50.000 et une implantation économique importante, un tel établissement semblait crucial pour la ville. ISCHS est le seul programme français homologué à Miami à former les étudiants du brevet au baccalauréat – l’École franco-américaine de Miami ne va que de la petite section au CM2. Pour autant, un élève qui arriverait en cours de lycée ne peut pas intégrer une classe « programme français » à ISCHS.
Victime de son succès, ISCHS doit refuser un nombre croissant d’étudiants. Quelque 1.000 élèves sont inscrits dans les programmes internationaux et un peu plus de 800 demandent à y entrer. Beaucoup d’entre eux sont inscrits en lycée américain et étudient le programme français par l’intermédiaire du CNED afin de pouvoir passer le baccalauréat.
Le Lycée français de Miami devait se composer d’un collège et d’un lycée. La première année, seuls les classes de 6eme, 3eme et 1ere S auraient été ouvertes. Les autres auraient été lancées progressivement jusqu’2018-2019. Objectif: former les élèves aux examens et tests français et américains. Quartier privilégié pour l’ouverture: Edgewater, pour son accessibilité depuis tout Miami et sa proximité avec la scène artistique de la ville.
Pour Jacques Brion, conseiller consulaire à Miami « le Lycée français doit être un effort collectif. L’offre de l’enseignement français à Miami doit être riche et variée et le lycée français manque pour le moment.»
6 visites guidées insolites de New York en français
Vos invités ne parlent pas anglais mais veulent découvrir New York? On vous a concocté une sélection d’organismes qui proposent des visites guidées originales en français. Suivez le guide.
1. New York Off Road
Fondatrice de New York Off Road, Elise Goujon (ci-dessus) est une jeune trentenaire nantaise éprise de New York depuis ses premiers pas ici. Arrivée il y a quatre ans dans la Grosse Pomme, elle a choisi de changer de voie pour réaliser son rêve : «l’énergie new-yorkaise m’a transcendé et donné envie de monter mon propre projet » explique t-elle. Accompagnée de guides certifiés, elle propose depuis trois ans des visites pour les francophones, avec différentes thématiques (« Louis Armstrong à Harlem », « Explorateurs de l’Ouest de Manhattan » ou encore « Les pieds dans l’eau à Red Hook »). Les groupes ne dépassent jamais plus de dix personnes pour que tout le monde puisse profiter des renseignements qu’elle dévoile.
Nous avons participé à la visite «Hipster de Brooklyn» . Elise Goujon a entraîné les participants du jour à travers des lieux emblématiques de Williamsburg dans le froid de janvier. Skyline, fabrique de chocolat, cafés, concepts stores et boutiques: les deux heures s’écoulent en un rien de temps. Un membre du groupe nous explique avoir choisi New York Off Road pour cette visite « hors des sentiers battus ». Pas question, en effet, de s’attarder à Times Square ou Central Park où « les touristes peuvent s’y rendre par eux même » glisse Elise Goujon. Une fois la visite terminée, toute la petite troupe reçoit l’itinéraire effectué par e-mail avec des conseils personnalisés pour chacun, marque de fabrique de New York Off Road. Infos et réservation ici.
2. Big Apple Greeter
Big Apple Greeter est une association de passionnés de New York qui proposent des visites guidées gratuites. Quelques « greeters » qui connaissent la langue de Molière vous emmènent dans leurs endroits préférés pour des rencontres et activités chaleureuses. Pensez à préciser votre langue de prédilection. Infos et réservations ici
3. Brooklyn Attitude
Brooklyn Attitude vous emmène dans les lieux emblématiques de Brooklyn comme Bushwick, Park Slope et Fort Greene. Certaines visites se font à pied ou en bus et c’est principalement Eliot, le fondateur de l’organisme qui est aux commandes pour vous faire découvrir ce “borough” en pleine mutation. Une visite d’environ trois heures à Brooklyn vous coûtera 35$ par adulte, 30$ pour les étudiants et séniors et 20$ pour les enfants. Infos et réservation ici
4. Harlem Spirituals
Harlem Spirtuals propose des visites culturelles de Harlem. Le dimanche, embarquez durant quatre heures pour un tour historique du quartier avec un aperçu des sites mythique comme l’Apollo Theater, le Cotton Club et une messe traditionnelle de Gospel. Le lundi et jeudi, l’ambiance est au jazz pour une visite en compagnie d’un passionné de musique. Pour les adultes, les premiers tarifs sont à 59$ et les enfants à 45$. Infos et réservations ici
5. Accueil New York
Les membres de l’association française Accueil New York peuvent participer à diverses visites dont celle du Metropolitan Museum en français le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Le prix est celui de l’entrée du musée. Il faut être membre pour y participer. Infos et réservation ici
6. FreeToursbyfoot
FreeToursbyFoot propose des tours privés de Greenwich Village ou encore Midtown Manhattan en français. Les prix varient en fonction de votre budget sur le principe du “name-your-own-price”. Pour signaler que vous voulez une visite en français, contacter l’organisme par e-mail. Infos et réservation ici
Un petit-déj sur le visa J-1 avec la FACC New York
La Chambre de commerce franco-américaine de New York (FACC) organise un petit-déjeuner sur les visas J-1 ce mardi 23 février au Cornell Club.
Le visa “J-1 Intern/Trainee” permet aux étrangers de faire un stage en entreprise aux Etats-Unis pour une durée de 18 mois maximum. Le rendez-vous a pour but d’informer les employeurs sur les derniers changements de réglementation relatifs à ce visa.
John Hamill et Jennifer Taler, associés au sein du cabinet Epstein Becker & Green, ainsi que Kristin Young, de la Chambre de commerce franco-américaine apporteront leur expertise sur le sujet. La discussion sera animée par Pierre-Georges Bonnefil, avocat à Epstein Becker & Green.
Et Voilà Théâtre en quête d'amis sur les planches à Houston
La troupe francophone « Et Voilà Théâtre » présente sa nouvelle pièce à Houston : «Les Amis du Placard».
Dans cette pièce de théâtre à l’humour grinçant, on retrouve Odile et Jacques, un couple de bourgeois qui vit une vie sans saveur. Un jour, ils décident de tuer l’ennui en achetant au supermarché… un couple d’amis.
Guy et Juliette sont donc soigneusement rangés dans un placard et sont utilisés au bon vouloir de leurs nouveaux propriétaires. C’est une comédie pleine d’humour, un peu dérangeante et qui se veut une réflexion sur la société de consommation. La pièce est à découvrir chaque week-end entre le samedi 27 février et le samedi 12 mars. Les textes seront en français avec des surtitres en anglais.
La pièce est au prix de 15$ pour les adultes, 10$ pour les enfants, les étudiants et les seniors.
Dating à New York: tout allait bien jusqu'à l'addition
Baptiste savait aussi qu’elle était “high maintenance” . Il avait opté pour un bar à vins chic de Midtown pour l’impressionner. Le genre où une trentaine d’autres “dates” tentent de s’apprivoiser dans une ambiance tamisée. Rapprochement des corps, effleurement des mains, regards qui ne trompent pas, rires et bon rouge: son “date” avec la belle brune de Boston était bien parti, et Baptiste pensait qu’il allait pouvoir la ramener chez lui.
Puis, l’addition est arrivée.
“J’ai proposé de partager et de prendre les tips. Elle m’a juste dit: C’est dommage, tu avais été parfait jusque là. Je suis rentré tout seul. Qu’étais-je censé faire? Elle s’était lâchée sur le vin et je n’avais mangé que des croquettes. Je ne pouvais pas payer tout ça! ”
En bons Français, notre éducation veut que l’homme régale, mais à New York, cette simple règle de bienséance peut vous ruiner. Avec la montée en puissance des app’ de rencontres, un célibataire peut avoir deux, trois “dates” dans la semaine, voire un tous les jours s’il le veut. Passer à la caisse à chaque fois fait mal à la fin du mois. Très mal. Comme un ami serial-dateur le confiait, “à la fin du mois, il ne te reste plus grand chose dans ton compte en banque. J’ai dû me calmer, me mettre à bouffer des cookies au petit-déj pour faire des économies” .
L’addition était déjà un point de débat entre hommes et femmes avant même l’avènement de Tinder et consors. Le web grouille d’avis parfois contradictoires sur qui doit payer, comme le montrent ces échanges sur le forum Quora en 2013 sur une situation où la femme décide de régler l’intégralité de l’addition. Selon l’institut Emily Post, éditeur de l’ouvrage Etiquette, référence en matière de manières aux Etats-Unis, “pour un premier date, la personne qui est à l’origine de la rencontre devrait payer à moins que les deux parties acceptent au préalable de partager les dépenses.” Mais là aussi, tout le monde n’est pas d’accord. “Au temps de Tinder, qui peut être considéré comme l’initiateur? Celui qui a “aimé” en premier? Celui qui a lancé la conversation? Vous pouvez voir que les choses sont devenues compliquées ces jours-ci” , faisait valoir Vogue.com en 2014.
Relayant un sondage réalisé en 2013, Forbes raconte que 59% des sondés pensent que c’est à l’homme de payer (50% chez les 18-23 ans, 71% chez les 67-82 ans). Les chercheurs qui sont entrés dans le détail se sont rendus compte que, malgré les changements sociaux de ces dernières décennies et la féminisation du marché du travail, le modèle traditionnel demeure quand l’addition arrive sur la table. “Quand les rôles sociaux commencent à changer, les individus adoptent les changements qui rendent leur vie plus simple, mais résistent à ceux qui les rendent plus difficiles”, selon David Frederik, professeur de psychologie à Chapman University et auteur d’une étude sur la question auprès de 17.000 personnes non-mariées. “Nous avons regardé qui payait pour les “dates” parce que c’est un domaine où les femmes pourraient résister plus aux changements que les hommes” a-t-il confié au Huffington Post.
“Gros, gros feu rouge”
Rachel, une Américaine qui habite à Brooklyn, est bien décidée à ne pas laisser l’égalité homme-femme progresser trop rapidement dans ce domaine. Pour elle, un homme qui ne l’invite pas lors du premier “date” est synonyme de “gros, gros feu rouge” . C’est pourquoi elle prend soin, lors des premières sorties du moins, de choisir “des endroits pas trop chers, des bars qui font des happy hour par exemple pour éviter de lui mettre trop la pression. En plus, chaque fille doit s’attendre quand elle sort avec quelqu’un à ce qu’elle ne soit pas la seule ‘date’ qu’il verra dans la semaine. C’est la réalité. Il faut s’y adapter. “
Chez les hommes, on sait trop bien que certaines conquêtes n’ont pas la même courtoisie que Rachel. Yann, 31 ans, raconte une récente relation: “Elle n’arrêtait pas de commander des choses. Un verre par-ci, un autre par là. A la fin du dîner, elle a insisté mollement pour payer, mais elle n’avait que quelques billets d’un dollar. J’ai compris le message et j’ai tout payé. Au bout de quelques dates comme ça avec elle, j’ai décidé de ne plus répondre à ses textos, dit-il. New York est une ville hors de prix. Je ne suis pas banquier. Je ne peux pas me permettre d’inviter quelqu’un à chaque sortie.”
Eloge de l’addition
Tout le monde devrait, en tout cas, se féliciter de l’existence de l’addition: c’est le seul moment de vérité pendant des rencontres qui ont tout d’artificiel. Pendant un “date”, les deux personnes l’une en face de l’autre peuvent se raconter à peu près n’importe quoi et se faire passer pour des personnages qu’ils ne sont pas. Dans ce grand jeu de rôle, l’addition remet les pendules à l’heure. La galanterie, la radinerie, le respect de l’autre, le niveau socio-économique: tout passe au révélateur. Mesdames, il s’absente pour aller aux toilettes juste après le dessert? C’est mieux de ne pas le rappeler. Messieurs, elle ne vous voit qu’à la fin du mois? Allez plutôt à la piscine. Charlotte, une Française de New York, se souvient par exemple d’un Américain qui a voulu partager l’addition car “il voyait d’autres filles dans la semaine” . Elle l’a mal vécu sur le coup, mais cela l’a aidée à passer plus rapidement à autre chose, et à trouver quelqu’un qui allait vraiment lui donner l’attention qu’elle méritait.
Avocate dans un grand cabinet, Cindy de Washington est allée dîner avec un homme qui lui a lancé “tu devrais m’inviter parce que tu es avocate, tu gagnes plus que moi. Ca m’a rendu folle. C’est comme s’il avait du mal avec le fait qu’une femme gagne plus que lui“, assène-t-elle sans vraiment réaliser la contradiction de son propos.
Alors comment faire pour que tout le monde soit heureux: partager tout dès le début pour être sur un pied d’égalité total? Partager à partir du 3ème date ? Faire une balade dans le parc plutôt que de se retrouver dans un bar à vins hors de prix? Rachel l’Américaine suggère un stratagème très – trop – ambitieux: “Les hommes devraient se calmer sur les dates. S’ils veulent dépenser moins d’argent, ils n’ont qu’à voir moins de filles et mettre un peu plus d’efforts dans celles qu’ils voient.“