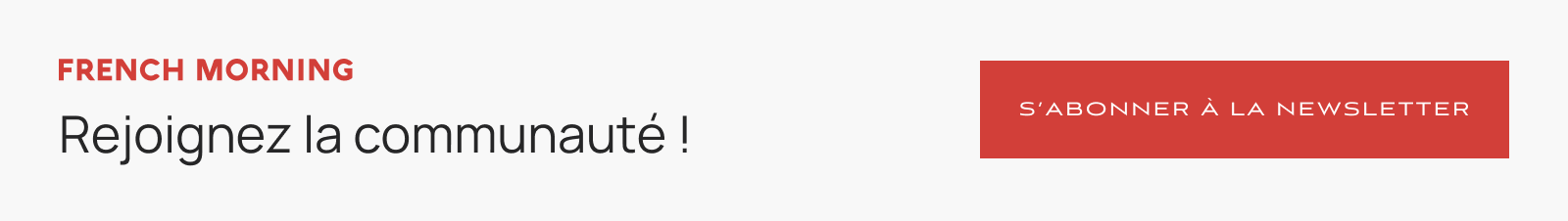La France n’est pas le paradis de la liberté des médias, à en croire un article du New York Times titré «liberté de la presse en France : le droit de dire ce que les hommes politiques veulent». L’article fait un petit tour des grands noms des medias en France : «Arnaud Lagardère qui appelle M. Sarkozy un “frère”, Martin Bouygues, parrain du fils de dix ans de M. Sarkozy, et Vincent Bolloré qui a prêté au président son jet et son yatch», aussi Bernard Arnault, «témoin de mariage de M. Sarkozy» et propriétaire de La Tribune. Le New York Times rappelle qu’Alain Généstar, rédacteur en chef de Paris Match «a été poussé dehors par M. Lagardère sous la pression de M. Sarkozy à propos de la publication en une d’une photo de Cécilia Sarkozy et son compagnon à une époque où elle était séparée de son mari», et que le JDD a enterré son enquête selon laquelle Cécilia Sarkozy n’avait pas voté au deuxième tour.
Doreen Carvajal et Katrin Bennhold notent qu’«il n’a fallu que quelques jours à Rue89 pour émerger comme un refuge online pour les articles politiques critiques et les lecteurs suspicieux de liens entre le nouveau président français et les barrons des médias du pays». (Le petit paragraphe fait bien plaisir à ceux qui ont un sac de couchage dans ce refuge «impertinent».)
France de rêve
Deux films sortis cette semaine sont l’occasion d’un petit tour dans une France de rêve : Sicko, le documentaire de Michael Moore, et, dans un genre différent, le dessin animé Ratatouille.
Pour ceux qui n’ont pas vu le film de Moore, sachez que dans une scène mémorable, il va voir un couple de Français et leur demande quels sont les plus gros postes de leur budget après la maison et la voiture (on imagine que des Américains parleraient de leurs frais médicaux ou l’université des enfants). «Ze fish», répond madame. Et puis, «ze vegetable», ajoute t-elle, pendant que la caméra se penche sur le bac à légumes.
«Oui, écrit le New York Times le portrait utopique de la France dans Sicko est peut-être exagéré, mais trouvez-moi un réalisateur – spécialement un primé deux fois à Cannes – qui ne soit pas Francophile.»
Le système médical français «n’est pas aussi superbe que l’affirme Sicko, mais il est plutôt bien», en profite pour expliquer Business Week.
Dans un classement récent de l’OMS, la France se classait première alors que les Etats-Unis étaient en 37ème position. On y apprend que la mortalité infantile en France est de 3,9 pour 1000, comparé à 7 aux Etats-Unis, l’espérance de vie, à 79,4 ans, est de deux ans de plus qu’aux Etats-Unis et que la France a plus de lits d’hôpitaux et de médecins par tête que l’Amérique. Les Etats-Unis pourraient s’en inspirer. Sauf que « {la France rembourse ses médecins à un taux bien inférieur à ce qu’accepteraient des médecins français». } En plus, «les médecins français n’ont pas d’écrasant emprunts étudiants à rembourser parce que leurs études de médecines sont payées par l’état» ni d’assurances exorbitantes à payer.
Ceci dit, les coûts de la santé augmentent aussi en France. Le système mériterait d’être réformé, observe l’article de Business Week, mais il y a peu de chance que cela se produise parce que les Français y sont très attachés. Et il reste moins cher et couvre mieux la population que le modèle américain. Et de citer Shanny Peers de la French American Foundation : «la France a un meilleur système pour moins cher, et tout le monde est couvert».
Après les hôpitaux français, les cuisines françaises. On y entre grâce à Ratatouille. «Le sujet (du film) c’est la nourriture, le héros est un rat et le décor la France. Les ingrédients de Ratatouille ne semblent pas trop appétissants. Mais essayez. Vous adorerez», écrit Newsweek sur son site internet.
Le rat Rémy quittera le giron familial pour réaliser son rêve: faire la cuisine du restaurant autrefois tenu par son héros Gustave Gusteau. «Ratatouille a peut-être l’air français, mais son message de réalisation de soi contre tous ne pourrait être plus américain».
Le Chicago Times s’est demandé comment Janeane Garofalo, la voix de la cuisinière Colette, avait appris à jouer une Française. «Je ne suis pas allée en France et je n’ai pas appris le français à l’école. J’ai juste imité un présentateur français sur CNN.»
Le producteur raconte dans Newsday que cela faitsait cinq ou six ans que l’équipe avait prévu d’appeler le film Ratatouille. «Mais à un moment, les types du marketing ont commencé à dire: et si les gens n’arrivent pas à le lire ? et s’ils ne peuvent pas le lire et pas le prononcer, ils ne peuvent pas en parler à leurs amis. Est-ce que c’est une bonne idée ?» Il est finalement allé défendre l’idée devant Steve Jobs (le patron du studio Pixar, producteur du film) pour avoir son feu vert.
En parlant de bouffe, «parfois dans la vie, vous êtes en train de manger une galette de riz sec en prenant une gorgée de boisson protéinée fadasse. Et un ami rentrant de Paris ou Lyon vous dit “les français vivent de fromage, de chocolat, de cigarettes et de vin et ils n’ont presque jamais de crises cardiaques et ils vivent plus longtemps que nous”. Serait-il possible que les Américains sacrifient inutilement leurs pêchés et plaisirs, pour avoir des seniors français qui portent des toasts à leur enterrement?» s’interroge Keith Humphreys, psychiatre de Stanford dans le San Francisco Chronicle (Ou plutôt fait semblant de s’interroger car il a la réponse : «le légendaire french paradox a été un peu exagéré par des gens qui aiment titiller leurs amis soucieux de leur santé, ou par des gens qui gagnent leur vie à vendre du fromage, du chocolat, des cigarettes et du vin». Mais les Américains gagneraient à prendre quelques habitudes françaises. Par exemple «les Français qui boivent de l’alcool ont tendance à ne pas varier la quantité de jour en jour. A la différence de beaucoup d’américains qui ne boivent pas d’alcool pendant la semaine et beaucoup le week-end, ce qui augmente le risque de crise cardiaque». Les Américains pourraient aussi manger des plus petites portions, et plus lentement «plutôt que de descendre des frites hamburger entre des messages de Blackberry», ce qui fait stocker du gras.
La modération, «c’est la meilleure leçon à retenir des Français».
Une revue de presse par semaine sur French Morning, pas plus.
Liberté de la presse, ratatouille et sécu
"Les Droits de l'Homme sont encore bafoués"
Fin de la projection. Les lumières se rallument. La salle remplie du Walter Reade Theater applaudit Laurent Herbiet qui entre sur scène. Le réalisateur se prête à une série de questions-réponses sur son film. « Je ne suis pas surpris de l’accueil favorable qui est réservé au film car il aborde un sujet peu utilisé dans le cinéma français » explique t-il. « Mon Colonel », sorti en novembre 2006, dans les salles françaises, traite avec réalisme de la torture organisée par la France durant la guerre d’Algérie. Fondé sur le roman éponyme de Francis Zamponi, « Mon Colonel » prend la forme d’une enquête militaro-policière qui fait des va-et-vient entre le présent (images en couleur) et la guerre d’Algérie (images en noirs et blanc).
Le fruit de son expérience
Sans verser dans le manichéisme, Laurent Herbiet, dresse un portrait accablant des responsables politiques et militaires français de l’époque. « Le but était de montrer que la torture n’était pas le fait de quelques moutons noirs mais qu’il s’agissait bel et bien d’un acte 
institutionnalisé par l’Etat français ». Le nom de François Mitterrand, Garde des Sceaux à l’époque, est d’ailleurs cité à plusieurs reprises. «C’est un exemple de ces nombreux hommes politiques complices des atrocités» assure le réalisateur. Pour son premier long métrage, Laurent Herbiet aborde un thème qui lui est proche. « Mon père a été appelé en Algérie après son service militaire. Il est resté six mois. Le problème c’est qu’on ne m’a rien appris à l’école sur cette guerre, c’est mon père qui m’en a parlée en premier». Ce sont ces hypocrisies que dénonce Laurent Herbiet. « La guerre d’Algérie a été reconnue officiellement comme une guerre en 1999. Mon père n’avait pas de statut d’ancien combattant car on considérait à l’époque qu’il s’agissait d’opérations de maintien de l’ordre ». De façon plus générale, c’est le fait d’occulter cette partie obscure de l’Histoire française que fustige le réalisateur. « Nous en avons honte alors nous n’en parlons pas. Je n’ai pas la prétention d’avoir fait ce film pour le devoir de mémoire. J’ai simplement voulu transmettre cette part de notre Histoire aux générations futures».
“La France n’est pas digne des Droits de l’Homme”
L’analyse de ce passé est loin de faire l’unanimité, comme en témoigne la polémique qu’a provoqué le projet de loi français en février 2005 sur le rôle positif de la présence française Outre-Mer. « Nous étions en tournage à Alger à ce moment » témoigne Laurent Herbiet, « les habitants étaient très en colère et nous aussi » ajoute t-il. Pour le réalisateur, les politiques français se voilent encore la face aujourd’hui. «Lorsque j’entends Nicolas Sarkozy dire qu’il faut être fier de notre passé et en finir avec la repentance, je trouve ça aberrant. La France prône fièrement les valeurs des Droits de l’Homme mais elle n’est pas digne de ce drapeau». Les Etats-Unis en prennent aux aussi pour leur grade. « Les Droits de L’Homme sont encore bafoués par de nombreux pays comme les Etats-Unis. C’est une grande démocratie, ils ont le devoir de donner l exemple mais ne le font pas. Preuve en est avec Guantanamo et la guerre en Irak » estime t-il.
Quant à l’impact de son film au festival Human Right Laurent Herbier relativise: « c’est important que ce genre de festival existe. Le problème est que l’on ne prêche que les convertis ». A eux d’apporter la bonne parole.
La French Touch de Ratatouille
« Paris avait déjà été vu de plein de points de vue différents, mais pas de celui d’un rat ». Brad Bird, le réalisateur de Ratatouille (qui en français se prononce « ra-ta-too-ee » précise le New York Times pour ses lecteurs qui n’en auraient jamais goûté), est venu y pallier. Grâce à Remy le rat, on y entre par les égouts pour émerger dans un Paris où les DS sont garées sur de vieux pavés et les Français, comme d’habitude, discutent en terrasse…
On se sait assurément en France quand le rat Remy par un trou d’un plafond sur lequel il court aperçoit un couple, béret et marinière à rayure, vissé par la passion « je t’aime, je te tue », bang coup de pistolet, et grand baiser. So French… (Notez que Michael Moore, dans son dernier Sicko, enchaîne aussi les images de roucoulades de couples français pour rappeler qu’il est à Paris.)
Remy le rat va aussi se promener sur le Pont Alexandre III, contempler le ciel de Paris au dessus des toits… On s’y croirait. Les dessinateurs de Ratatouille disent avoir fait une utilisation limitée des couleurs pour traduire au mieux la lumière parisienne (autrement connue comme le gris).
Aux côté de Remy, le fantôme de Auguste Gusteau, le chef cuisinier qu’il a mis sur un piédestal pendant toute sa vie de rat, et qui vient de mourir d’une crise cardiaque après une mauvaise critique (les petits enfants américains ne décoderont peut-être ps la référence au suicide de Bernard Loiseau). Remy arrive dans le restaurant de feu Gusteau où son successeur, sacrilège, décline sa marque sur des burritos surgelés. Le petit rat se lie d’amitié avec le garçon chargé des poubelles qu’il mettra aux fourneaux, tirant les ficelles (ou plutôt les cheveux) dans l’ombre, tel un Cyrano de Bergerac des casseroles, pour lui faire cuisiner des merveilles.
Guy Savoy, Taillevent, Tour d’Argent…
L’immense cuisine du restaurant, que l’équipe du film a mis deux ans à concevoir, donne envie d’arrêts sur image pour en examiner chaque détail. L’auteur de ces décors, Harley Jessup, dit avoir visité des quantités de cuisines de restaus français. Mais il a été obligé à un compromis : les cuisines américaines sont bien plus ouvertes que celles, pleines de recoins, des chefs français. Le résultat est une cuisine ouverte aux stations séparées. Quant au balai des cuisiniers, l’équipe de ratatouille est allée en Californie filmer les cuisines et les casseroles du French Laundry, le restaurant de Thomas Keller, consultant de Ratatouille. Même le plateau de fromage, copié du restaurant d’Hélène Darroze, n’a pas été laissé au hasard.
La salle à manger de chez Gusteau a été composée à partir de plusieurs adresses parisiennes comme Guy Savoy, Taillevent, La Tour d’Argent et Le Train Bleu. Notez l’anti-cliché : le serveur n’est ni hautain, ni mufle quand il prend les commandes, contrairement au stéréotype hollywoodien du garçon français.
Sans aller jusqu’au sous-titrage, les Français de Ratatouille (souvent minces et en cols roulés noirs) parlent avec l’accent de chez nous (qui n’est pas aussi suave que l’accent français d’Angelina Jolie dans a Mighty Heart). La difficulté, explique le dossier de presse du film, était de faire faire des mouvements de bouche français à tous ces personnages. « Quand quelqu’un parle en français, les formes de sa bouche sont différentes » à en croire Mark Walsh le chef des dessinateurs, qui raconte qu’ils se sont nourris de grands classiques français pour créer leurs personnages, s’inspirant même d’icônes françaises comme Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg et même… Charles de Gaulle (on ne les a pas reconnus).
Mais pour ce travail d’observation, l’équipe de Ratatouille n’a pas gardé de Français en cage. Alors que c’est ce que les dessinateurs ont fait avec des rats pendant des mois pour pouvoir apprécier tous leurs mouvements.
A French Morning, on a quand même décelé quelques erreurs factuelles dans cette Ratatouille. Par exemple, le frigo de Linguini est bien trop gros pour un frigo français. En avez-vous trouvé d’autres ?
Où manger de la ratatouille à New York
Aquagrill Menu
210 Spring St., près de Sixth Ave – 212-274-0505
Provence
38 Macdougal Street
Pascalou
1308 Madison Ave- à 93rd St – 212 534-7522
Bistro du Nord
1312 Madison Avenue – 212-289-0997
Le Gamin Menu
536 E. 5th St. près de l’avenue B – 212-529-8933
Crepes on Columbus
(La ratatouille est dans la crêpe)
990 Columbus Ave entre 108th St & 109th St – 212-222-0259
Pastis
Ninth Ave. (et Little W. 12th St)
212-929-4844
La mangeoire
1008 Second Ave et 53rd Street – 212 759-708
Comment faire sa ratatouille
La recette de la ratatouille en français et en anglais
Vie privée / vie publique en France et aux U.S.
« La France et les Etats-Unis ont eu l’air d’être les meilleurs amis dimanche », écrit le New York Times après la rencontre en France de la sécrétaire d’Etat Condoleezza Rice et du ministre des affaires étrangères Bernard Kouchner sur la crise au Darfour. « Il n’y avait aucune trace des tensions qui ont marqué les relations du gouvernement Bush avec l’ancien président Jacques Chirac ».
L’éditorialiste Jim Hoagland est encore plus euphorique dans le Washington Post. « Le nouveau président de France est un ouragan d’air frais », écrit-il, « en cinq semaines, Nicolas Sarkozy a conçu un gouvernement comme aucun que les Français n’aient eu jusque là, en terme de diversité et d’ouverture politique. » C’est une équipe qui « va au-delà de tout ce qu’a déjà pu faire une administration américaine – sans parler des gouvernements français – en terme de diversité ethnique, sociale et politique, et d’audace». Avec Kouchner, Sarkozy et Jean-David Lévitte, l’ancien ambassadeur conseiller en affaires étrangères, « l’Histoire a présenté au gouvernement Bush un cadeau important qu’il ne devrait pas ignorer ».
Le Boston Globe consacre un éditorial à la séparation de Ségolène Royal et François Hollande. La phrase de Ségolène invitant son compagnon à quitter le domicile pour vivre son histoire sentimentale « a été décodée dans la presse française comme une allusion à la liaison de Hollande avec une journaliste de Paris Match, (…) qui a couvert les socialistes et écrit des portraits admiratifs du leader socialiste ». « Si c’était une pièce de Molière, les personnages parleraient en alexandrins, le public de la Comédie Française auraient des sourires amusés. Mais la farce jouée par Royal et Hollande n’est pas vraiment drôle pour leurs collègues et électeurs socialistes ».
Une campagne électorale ne fonctionne pas comme une comédie, rappelle le Boston Globe. « Hollande peut-il espérer être pris au sérieux quand, malgré le projet de Royal de le remplacer à la tête du parti socialiste, il insiste pour dire que leur séparation est purement une « affaire privée » et n’a pas de « causes ou conséquences politiques » ?».
L’éditorial du Boston Globe concède que « la vie privée d’un homme politique ne doit pas être considérée comme un indicateur de sa capacité à conduire des affaires d’état. Mais les électeurs n’aiment pas qu’on leur mente, que cela vienne des hommes politiques ou des journalistes qui les couvrent. Ni en Amérique, ni en France ».
Le Washington Post s’amuse de l’interdiction du BlackBerry dans les bâtiments du gouvernement au nom de la sécurité nationale. Même si, ce type de téléphone « est bien plus populaire dans les Etats-Unis accros au travail qu’en France – un pays dont les citoyens protègent farouchement leur courte semaine de travail et leurs longues vacances ».
Brut de femme
Un regard bleu azur, une chevelure dorée, un sourire ravageur. Du haut de ses 1m86, Marie Line a moins l’allure d’une chanteuse de Hip Hop que d’un mannequin suédois. « J’ai fait du mannequinat quand j’avais 17 ans» se souvient-elle, «le problème c’est que je ne rentrais pas dans les vêtements, j’étais trop grande ». Trop atypique sans doute aussi.
Cette niçoise, expatriée à New York dés l’âge de 18 ans, s’est toujours refusée à suivre une ligne directrice. Préférant saisir les opportunités qui se présentent, Marie Line se plaît à goûter aux plaisirs de la vie pour n’en garder que le meilleur. « Adolescente, je voulais être joueuse de tennis comme mon père et mon frère. Ensuite, j’ai fait du théâtre durant deux ans à New York. Puis, j’ai fait des apparitions dans Sous le soleil ou dans la série américaine Rescue me. J’ai aussi jouer dans un long métrage américain qui sortira cet automne». Se lancer dans la musique peut sembler être une suite logique pour cette autodidacte, cela n’a pourtant pas été aussi simple.
Marie Line l’inclassable
« Je n’ai pas eu d’éducation musicale. Mes parents n’écoutaient jamais de musique » explique t-elle. En fait, c’est par besoin que Marie Line s’est mise à écrire. « Quand je suis arrivée à New York j’étais perdue car je ne savais pas quoi faire. C’était assez délicat surtout dans cette ville où tout va si vite, j’avais besoin d’écrire pour me ressourcer ». Il a alors fallu faire ses premières armes dans un milieu exigeant. « J’ai fait mes trois premières chanson à Londres. Je suis ensuite allé frapper à la porte de maison de disque en France mais ils n’ont dit d’affiner mon style » soupire t-elle. De quoi déplaire à cette néophyte de la chanson qui n’a aucune envie « d’être mise dans une case » pour ne plus pouvoir en sortir. Marie line est inclassable. Ses mélodies vont du Hip Hop, au R N B en passant par la pop. « J’aime beaucoup des artistes comme Kamaro pour l’aspect show à l’américaine de sa carrière, J-LO et Christina Aguillera pour leur coté sexy. En ce moment c’est Diam’s que je préfère. Ces textes sont forts, elle parle crûment de choses qui fâchent ».
« Je ne suis pas romantique »
C’est justement ce qui caractérise les paroles des chansons de Marie-Line. Elle aborde sans détour ce qui choque. Son thème de prédilection : les femmes, leurs désirs, leurs envies, leurs fantasmes. « Je suis fascinée par la puissance de séduction des femmes. Je ne suis pas féministe mais je revendique le droit de pas se cantonner à un rôle de femme mariée». Et ce, quitte à être politiquement incorrect. Avec sa chanson « Quand je te vois je pense à ça », Marie Line parle d’une femme qui souhaite simplement se livrer au plaisir charnel. Un brin autobiographique ? « Même si j’évoque les femmes en général, je parle aussi de moi. Je ne suis pas romantique, j’ai toujours été séductrice dans l’âme » s’amuse la chanteuse. « Les autres femmes pensent comme moi mais le cache. J’ai envie de porter ce message pour dire les choses crûment telles qu’elles existent ».
Cette sensualité décomplexée, Marie line la chantera vendredi soir. «J’appréhende un peu la réaction du public mais cela rend mon concert terriblement excitant ». Marie Line a une 10e de chansons de ce type à son répertoire, pourtant elle compte bien varier les plaisirs en écrivant sur des sujets plus politiques notamment sur la France et « la capacité des Français à toujours se plaindre ». Mais pour l’instant sa priorité est de trouver un producteur. « J’essaye de travailler dur sur scène pour qu’un jour quelqu‘un me remarque le plus tôt possible ». Dés vendredi soir peut-être.
Cutting Room, 29 juin à partir de 19H30. Admission 15 dollars
site de Marie-Line
Une Green card en gros lot
« Félicitations ! Vous avez été tiré au sort pour recevoir une Green Card. » C’est sur ce courrier que Gilles Lambert, 28 ans, est tombé un soir d’avril 2006, à Paris, en rentrant du bureau. C’est alors qu’il s’est souvenu s’être inscrit, un an auparavant, à la fameuse « Green Card Lottery », ce programme gouvernemental américain qui attribue, chaque année, 50 000 visas de résidents permanents à des ressortissants du monde entier par tirage au sort.
Pour ce natif de Sedan, diplômé en droit, et juriste d’entreprise à la FNPS (Fédération de la Presse d’Information Specialisée), l’occasion était trop belle pour la laisser passer. « Je n’avais jamais vécu à l’étranger et j’avais très envie de changement. » Il a donc conscienceusement franchi toutes les étapes qui devaient le mener vers l’obtention du fameux sésame. « Les formalités administratives ne sont pas très lourdes, mais il faut nénanmoins pouvoir justifier du baccaulauréat, ou de deux ans d’expérience professionnelle, d’un casier judicaire vierge, d’une situation militaire en règle, et passer une visite médicale auprès d’un médecin agrée ».

En octobre 2006, au moment de se rendre à l’ambassade des Etats-Unis à Paris pour venir chercher son VISA, Gilles savait déjà qu’il mettrait le cap sur New York. Deux ans auparavant, il était venu rendre visite à des amis expatriés, et la ville l’avait immédiatement séduit. C’est d’ailleurs à son retour de vacances que l’idée de jouer à la loterie lui était venue. Manque de chance : les inscriptions venaient tout juste de se clôturer. Un an plus tard, en naviguant sur Internet, il est retombé par hasard sur le site officiel du gouvernement américain. Cette fois-ci, il était dans les temps.
Comme lui, 5,5 millions de personnes ont tenté leur chance à la cuvée 2007 de la loterie, officiellement denommée « Diversity Immigrant Visa Program ». Depuis Williamsburg, dans le Kentucky, où ils officient, les 75 employés en charge de ce service pas banal ont électroniquement tiré au sort 82 000 candidatures, pour attribuer, compte tenu des desistements et des dossiers recalés, 50 000 visas de résidents permaments. Statistiquement, Gilles avait donc une chance sur 67 de remporter le gros lot. « C’est incomparablement plus que la probabilité de gagner au loto », convient-il aujourd’hui.
Contrairement aux idées reçues, les services de l’immigration n’appliquent pas de quotas par pays. Le tirage au sort se fait de manière aléatoire en fonction des dossiers reçus. Seul restriction : aucune nation ne peut cumuler plus de 7% des visas accordés dans le cadre du Diversity Immigrant Visa Program.
En 2007, 365 Français, 6 871 Ethiopiens, 4 922 Marocains, 5901 Bengali, 1988 Alabanais, 488 Brésiliens, 214 Italiens, 97 Espagnols, 80 Irakiens, 7 Chypriotes et un Monégasque, parmi bien d’autres nationalités, ont décroché le gros lot. Tous ne feront peut-être pas le grand saut vers les Etats-Unis. Mais Gilles, lui, n’a pas hésité. Il a quitté son travail et son appartement parisien pour venir s’installer à New York en avril dernier. En moins de trois jours, il avait déjà trouve un logement Upper East Side. Il est aujourd’hui à la recherche d’un emploi, soit dans le secteur de la presse, soit dans une agence de photo du type Getty Images ou Corbis. Mais il hésite à s’enroler comme stewart dans une grande compagnie aérienne. « Ce pourrait être l’occasion d’être payé pour faire le tour du monde », déclare-t-il avec un air rêveur. « J’ai envie de voir du pays ». Décidément, la loterie lui a donné plus qu’une Green card : des ailes pour changer de vie.
La loterie, une curieuse invention menacée de disparition

De tous les types de Visas que délivre le gouvernement américain, celui réservé aux gagnants du « Diversity Immigrant Visa Program » est le de loin de plus insolite. Cette mesure a été introduite par le Congrès américain en 1992 pour rétablir une certaine équité dans les quotas d’immigration. Constatant que la proportion de Visas accordés aux Europeens du Nord avait largement diminué entre 1960 et 1990 au profit des Latinos-Américains, des Africains et des Asiatiques, le législateur imagina un programme correctif s’appliquant à un nombre limité de pays, de préférence anglo-saxons. C’est ainsi que les Irlandais eurent droit à 40 % des « Diversity Visas » accordés entre 1992 et 1994. En 1995, lorsque cette exception expira, le Congrès décida que le programme devrait couvrir le monde entier, à l’exception des pays ayant déjà envoyé plus de 50 000 immigrants dans le cours de l’année précédente.
Pas de critères de sélection, ou presque, pas de discrimination par pays, ni de frais d’avocats à payer : pour des millions de gens dans le monde, la loterie américaine représente l’occasion inespérée de franchir légalement les frontières de l’Amérique.
Sauf que depuis l’adoption du Patriot Act et le début de la guerre contre le terrorisme, son existence est menacée. Tous les ans en effet, des ressortissants de pays considérés comme suspects par les Etats-Unis – Iran, Cuba, Lybie, Pakistan, Corée du Nord, Syrie ou encore Soudan –, et normalement interdits de Visas de touristes, figurent sur la liste des gagnants. Et si des terroristes profitaient de ce biais pour s’infiltrer ?
Fustigeant les failles du programme, ses détracteurs ont essayé à quatre reprise de l’abolir. En vain, la Chambre des représentants ayant rejeté leur requête. Mais dans un pays qui prend sa sécurité autant au sérieux, cette exception est menacée.
En attendant, le suspense est lancé pour les participants à la cuvée 2008 de la loterie, qui avaient jusqu’au 3 décembre dernier pour s’inscrire. Les dates exactes du dépôt de candidatures pour l’édition 2009 ne seront annoncées qu’en août prochain, mais vous pouvez d’ores et déjà tabler sur une fourchette de trois deux mois comprise entre début octobre et début décembre. A surveiller de près sur le site du gouvernement
"Le système de santé français montre qu'on peut couvrir tout le monde"
French Morning : Quelle est la philosophie et le principe du système de santé américain ?
Victor Rodwin : Sa philosophie, c’est un système dominé par les employeurs . Presque 60 % de la population est couverte par ce système d’employeur comme les mutuelles en France, avec des couvertures différentes, des primes différentes, des HMO* (Health Maintenance Organisation) différents.
A côté , il y un autre système pour les personnes âgées que l’on appelle Medicare qui couvre aussi les personnes gravement handicapées et puis enfin il y a un système pour les très très très pauvres qui est géré conjointement par gouvernement fédéral et les Etats qui s’appelle Medicaid. Enfin, Il faut ajouter un système pour les anciens combattants et les militaires. Globalement la plupart des américains travaillent dans des grandes ou petites entreprises et sont donc couverts. 
Quelle est la part des non couverts ?
VR : Cela représente entre 16 et 18 % de la population c’est-à-dire 46 millions d’américains. En général la majorité de cette population travaille, ce ne sont pas des chômeurs, ils sont employés dans des petites entreprises de moins de 12 personnes comme les Mc Do par exemple. Ils n’ont pas de couverture. Cela ne veut pas dire qu’ils meurent dans la rue ou qu’ils ne sont jamais soignés. Pas du tout, ça c’est un mythe français, ces personnes peuvent se rendre dans un réseau d’hôpitaux publics qui existe dans la plupart des villes américaines ou dans des centres pour personnes défavorisées. Ces personnes reçoivent des soins inférieurs à la norme. Le taux de mortalité pour ces populations non couvertes est de 25% supérieur à la population générale. Donc c’est un système assez inégalitaire.
Quels sont pour vous les problèmes que doit affronter le système de santé américain ?
VR : Le premier problème c’est de couvrir toute la population parce que cela n’a aucun sens économique de continuer à ne pas couvrir une certaine partie de la population puisque finalement on paie pour les soigner à l’hôpital tant qu’ils sont vivants. Ils finissent à l’hôpital et ça coûte beaucoup plus cher.
2 ème point, c’est le même problème qu’en France, il faut reformer le système et le moderniser. Aux Etats-Unis et en France, c’est un système anachronique, sans transparence, avec des différences de qualités invraisemblables entre les régions, entre les classes sociales, entre les hôpitaux. La population n’est même pas au courant de ces disparités énormes.
Nous avons le meilleur et le pire aux Etats-Unis. Nous avons des hôpitaux extrêmement performants et des hôpitaux moins performants, nous avons des variations énormes, nous avons des HMO, des système de »managed care » qui fonctionnent très bien, comme la Kaiser Permanente http://www.kaiserpermanente.org ou Puget Sound http://www.pugetsoundhealthalliance.org/news/other.html et nous avons des systèmes côtés en bourse très inégaux. Certains fonctionnent bien d’autres sont de vrais scandales en tirant des profits du système sans délivrer les biens nécessaires. Nous avons une concurrence portée beaucoup trop sur la sélection du risque et pas suffisamment sur la qualité des soins. Nous avons une idéologie de concurrence très importante qui n’existe pas en France dans le système de santé.
Justement, comment définiriez-vous les grandes différences entre les systèmes français et américains ?
VR : En France, c’est un système national, assez centralisé, peut être trop centralisé qui couvre toute la population tandis que chez nous nous avons des systèmes avec des bénéfices différents pour différents groupes, différents médicaments remboursés de façon variable s’il on dépend du Medicaid, Medicare ou des assurances privées. Il en existe des centaines et des centaines. Donc il ya une uniformité dans le financement et dans le pratique plus grande en France, mais avec tout de même des variations importantes. Ce qui manque en France c’est la transparence et la connaissance (par le grand public) de ces différences.
Pour vous on peut vivre sans être assuré aux Etats-Unis?
VR : Il ya très peu de gens très riches qui vivent sans assurance, mais la plupart des personnes qui vivent sans assurance sont des personnes qui travaillent. Ce ne sont pas des chômeurs, mais ils sont pauvres et pourtant, pas suffisamment pour bénéficier du programme Medicaid. Aux Etats-Unis les plus pauvres sont couverts pour tout. Mais ils n’ont pas le meilleur accès aux soins, ils ont accès aux hôpitaux , pour les soins primaires. Pour tout ce qui est préventif ils sont en général très mal pris en charge parce que les taux de remboursement sont moindres que ce que paie le secteur privé.
Avez-vous l’impression que la reforme du système de santé sera l’un des grands débats de la présidentielle américaine de 2008 ?
VR : c’est possible mais nous avons déjà eu ce débat en 1992, à l’époque Clinton, et nous avons déjà échoué dans le défi de mettre en place un système national d’assurance maladie pour tous. L’idée d’Hillary Clinton c’était d’une part de couvrir toute la population et d’autre part de moderniser le système de production de soins, de réduire le rôle de la médecine à l’acte, de mettre les médecins dans des groupes et de faire du « managed care » pour toute la population. C’est une idée qui ne marcherait jamais en France . Ici, pour l’instant nous sommes encore dans un système pluraliste qui fonctionne très bien pour la majorité du pays mais très mal pour les non-assurés. Il ya de plus en plus d’américains qui perdent leur assurance du fait des employeurs. Il ya des pressions comme en 1992 pour reformer le système mais il y a encore une croyance que ce système peut être réparer par des mécanismes de marché . Je pense que c’est une grande illusion.
Que pensez vous de la décision du Massachusett de mettre en place une couverture universelle pour les habitants de cet Etat . C’est comme cela, par des initiatives locales que la couverture va s’étendre progressivement à tous aux USA ?
VR : Non, on n’y arrivera jamais comme cela, ce n’est qu’une loi, il faut encore la mettre en oeuvre et la financer . Donc on est loin de résoudre le problème dans le Massachusetts ou en Californie. Ces 2 Etats sont parmi les plus riches des Etats-Unis, parmi les plus éclairés du pays mais ça ne va pas résoudre le problème de la Géorgie, du Texas, de l’ Alabama. On ne peut pas s’y prendre Etat par Etat, à mon avis. Il y aura des expérimentations intéressantes, c’est la décentralisation, la déconcentration américaine qui sont tout à fait valables mais ça ne va pas résoudre le problème sur le plan national.
Est-ce que selon vous le système français est implantable aux Etats-Unis?
VR :Non aucun système n’est implantable. Dès que l’on prend un système et que l’on essaie de le mettre dans un autre pays, il y a une procédure de sécrétion d’anticorps qui est énorme et qui rend “l’implantation” impossible . Le but de la comparaison internationale, le but de ce livre c’est plutôt de s’inspirer des idées, de voir ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher et d’en tirer certaines leçons. Dans ce sens là, le système français montre qu’il est possible de couvrir tout le monde sans éliminer complètement l’assurance maladie privée. Déjà c’est une leçon importante. Et ce que l’Amérique s’en inspirera ? A voir…
* Les HMO sont un type d’assurance santé particulier. Les assurés paient moins cher, mais ils doivent passer par un médecin référent et les soins sont encadrés par des règles précises, certains traitements jugés inefficaces notamment sont exclus.
Victor Rodwin vient de publier «Universal Health Insurance in France : how sustainable ?», ouvrage collectif.
Chinatown vu autrement
Jane Lombard est à l’honneur pour sa première exposition. Tout juste diplômée d’une école de graphisme parisienne, cette française de 24 ans a posé ses valises à New York il y a un an pour travailler en tant qu’assistante-photos.
Elle connaissait déjà un peu la ville pour y avoir fait un stage en 2003 mais ne se lasse pas de l’arpenter à l’affut du sujet idéal. 
« Je cherche toujours des angles, un attitude, ou quelque chose qui se passe d’inhabituel », dit-elle. Rien de plus facile pour elle qui habite à quelques blocs de Chinatown d’aller y prendre des photos, fût-ce à 6 heures du matin pour suivre la livraison des poissons.
Les minorités et les enfants sont ses sujet de prédilection, Chinatown lui tient donc naturellement à cœur. « Il y a beaucoup de vie et j’adore être dans la foule », confie-t-elle.
Depuis un an, Jane Lombard s’est ingéniée à capturer au vol la vie quotidienne du quartier, le départ du métro, l’affairement dans les épiceries, les enfants dans les rues. « Je ne veux pas les interrompre dans ce qu’il font. J’arrive le plus vite possible et le plus discrètement possible pour avoir le plus naturel possible » explique-t-elle en présentant ses 20 clichés dont l’un été exposé au Palais de Tokyo à Paris.
Loin des panneaux publicitaires bigarrés du quartier, la jeune Française a pris le parti de prendre uniquement des photos argentiques en noir et blanc pour s’attacher à l’essentiel. « Cela fait ressortir le côté graphique, on voit plus la composition que les couleurs ». L’américain Frank Thompson a également choisi le noir et blanc pour les quelques clichés qu’il expose dans la galerie.
La couleur l’emporte en revanche sur le mur opposé. Un système d’air conditionné miniature, un kit de toilette complet, un ordinateur portable ou encore des chaussures, le tout en papier… Détrompez-vous il ne s’agit pas de l’attirail d’une petite fille chinoise mais d’objets funéraires. La tradition chinoise veut que lors d’un décès, on brûle ces objets en papiers au temple ou devant la porte du défunt pour assurer son confort dans l’au-delà. Rien n’est gratuit ici-bas et la situation n’est guère plus enviable dans l’autre monde. Les proches du défunt veillent donc à lui faire parvenir un peu d’argent de poche, en faisant offrande de billets imprimés par la « Bank of the otherworld ».
La française Virginie Sommet installée à New York depuis 8 ans et auteur du livre “Only in New York, Darling” est l’une des rares artistes à avoir une galerie à Chinatown. Elle s’est inspirée de « L’urinoir » de Marcel Duchamp et du concept du « ready-made ». Selon elle, le simple fait d’exposer ces objets apparemment anodins dans une galerie en fait des œuvres d’art. Les miniatures en papier ne sont pas même retouchés. C’est avant tout leur côté insolite qui a séduit Virginie Sommet. Bien que toutes oeuvres exposées soient à vendre, « C’est pas du tout l’argent qui m’intéresse sur ce projet là », dit-elle, « c’est le fun of It ». Quelques unes de ses œuvres issues de sa série « Méditation » sont également exposées dans le cadre de l’exposition aux côtés de celles du graphiste Gary St. Clare qui a travaillé sur les ombres chinoises.
Gallery 171-173.
171 Canal St.
Ouverte sur rendez-vous jusqu’au 9 juillet.
Contactez Virginie Sommet au 646.245.6072
virginiesommet.com
Heureux comme un Québecois
« Venir ici ça représente la chose la plus bizarre qui me soit arrivée dans ma vie. Si on m’avait demandé dans quelle ville je voulais jouer pour la Saint-Jean, New York est la dernière à laquelle j’aurais pensé ». Ce soir Pépé jouera pourtant bel et bien dans la ville qui a vu défiler les plus grands chanteurs.
«Je suis très heureux de venir ici. C’est la première fois que je vais jouer à l’extérieur du Québec pour la Saint Jean. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre. J’appréhende un peu la réaction du public » avoue l’artiste.
Pourtant Pepe n’est plus un novice dans l’univers musical Québécois. Grand gagnant de la 21e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée en 2003, gagnant du 7e concours Découverte de la chanson de Magog et finaliste du concours Cégep, Pépé a aussi représenté le Québec au festival international de musique de Belfort, où il a raflé tous les honneurs. Il a récemment sorti un troisième album « cent pour cent bœuf », savant mélange de folk, rock et punk. « Mes chansons restent dans la tête des gens car elles sont légères. Je ne suis pas le genre d’artiste qui va dire pour qui voter, je veux juste donner du bonheur aux gens » explique Pépé.
Ce soir encore la fête nationale du Québec sera l’occasion pour lui de s’amuser plus qu’autre chose. « En fait je ne suis pas un expert en patriotisme » s’excuse le chanteur. « Pour moi, la Saint-Jean c’est surtout le début de l’été, l’occasion de faire la fête et de boire plus qu’à l’accoutumée ».
Pépé ne sait pas encore quelles chansons il va jouer ce soir ni devant combien de personnes. Ce qui est sûr c’est qu’il y mettra « toute son énergie et toute sa passion ».
Comme d’habitude.
Samedi 23 juin, de 6 h à 11h pm.
ARENA
135 W 41st Street (entre Broadway et 6th Ave)
Hermès débarque à Wall Street
C’est Robert Chavez, président directeur général d’Hermès USA qui a convaincu ses supérieurs sceptiques d’implanter le premier magasin de luxe dans ce quartier sinistré après le 11 septembre. « Nous sentions tous l’importance du redéveloppement de Downtown New York » dit-il. Robert Chavez assure que le quartier est en pleine ébullition. D’après lui, Wall Street était désert après 5 heures du soir il y a encore quelques années, mais les restaurants fleurissent et l’on construit de condominiums. Outre les hommes et femmes d’affaires, Hermès espère donc que les touristes et les habitants viendront pousser sa porte au 15 Broad St.
La calèche d’Hermès autour du monde
Un pari osé qui reflète l’espoir que le gourpe place dans le marché américain. « Aux Etats-Unis on a un énorme potentiel » affirme Patrick Thomas qui a succédé à Jean-Louis Dumas à la tête d’Hermès International en 2006. 
L’implantation d’Hermès aux Etats-Unis ne date pourtant pas d’hier. Le premier point de vente avait ouvert en 1924. Depuis, grâce à la publicité d’icônes comme Grace Kelly (inspiratrice du sac Kelly), Jacky Kennedy ou encore Audrey Hepburn, Hermès s’est forgé une solide réputation. Les magasins se sont multipliés dans les années 1990 mais c’est la reprise de la ligne de prêt à porter par Jean-Paul Gautier en 2003 qui propulsé Hermès au devant de la scène américaine du luxe .
64 magasins existent déjà à travers le pays et de nouvelles ouvertures sont prévues l’année prochaine à Denver et à San Diego. Dans la décennie à venir, Hermès compte conserver le rythme de deux à trois inaugurations par an sur le sol américain. «Il n’y a pas beaucoup de lignes qui ne marchent pas aux Etats-Unis» se félicite Patrick Thomas. La maroquinerie et la soie reste les produits phares mais la gamme de prêt à porter, les bijoux, les parfums et les articles de maisons se vendent également très bien assure-t-il.
Le marché américain de 250 millions de dollars ne représente pourtant que 16% du chiffre d’affaires mondial d’Hermès International. La maison de luxe est solidement implantée en Asie, notamment Corée du Sud et au Japon et se lance désormais à l’assaut du marché chinois. Un nouveau magasin vient d’être inauguré vendredi à Hangzhou. Au premier semestre 2007 l’activité du groupe a augmenté de 6,5%.
La qualité plutôt que les paillettes
Aux dires du patron, la clef du succès est de se tenir éloigné des paillettes. « Je crois que les gens s’intéressent de moins en moins au côté luxe, ce qui les intéresse c’est le bel objet », explique Patrick Thomas.
« Nous jouons beaucoup la discrétion ». La société est cotée en bourse mais encore gérée à 72% par les héritiers du fondateur Hermès. Repoussant le côté ostentatoire de certaines entreprises de luxe, Patrick Thomas ne parle pas de groupe mais de “maison” et préfère mettre en avant le travail d’artisanat réalisé pour chaque produit.
Que ce soit pour un sac, un bijou ou une assiette l’entreprise tient à chercher les savoir-faires là où ils sont. Ainsi, la plupart des produits sont fabriqués en France mais les montres Hermès sont produites en Suisse. Au total, Hermès emploie 6700 employés à travers le monde.
Tu tires ou tu pointes?
Platanes, chaises de jardin et boules…Tout y est ou presque, point de cigales mais des sirènes, points de pastis mais de la Vitamine Water. Eh oui, vous n’êtes pas à Saint Rémy en Provence mais bien au coeur de New York, à Bryant Park.
Le temps d’une pause déjeuner, les New Yorkais travaillant aux alentours du jardin retroussent leurs manches et desserrent leur cravate pour tenter d’approcher le cochonnet. Chacun peut joindre la partie et bénéficier des conseils avisés des membres de La Boule New Yorkaise. 
Il y a presque 40 ans, Alfred Levitt, peintre américain proche de Marcel Duchamp fondait le club au retour d’un voyage en Provence. Depuis, La Boule New Yorkaise n’a eu de cesse de promouvoir la pétanque – «pronouced paytonk» est-il précisé sur le feuillet d’information- et le jeu a peu à peu pris le pas sur son homologue italien, la Bocce.
A Bryant Park durant la semaine, les amateurs de boules se retrouvent le week-end à Washington square. S’ils «pointent», «tirent» ou «commandent», la petite centaine de membres est loin d’être exclusivement francophone. Américains, cubains ou cambodgiens se prêtent au jeu et s’entraînent pour les tournois.
Championnats du monde
Car attention, pour les membres de La Boule, bien plus qu’un jeu la pétanque est un sport. « Quand on arrive à un certain niveau, je vous prie de croire que ce sont des marathons » n’hésite pas à affirmer, Xavier Thibaud. Premier maître d’Hôtel au consulat général de France, il n’a pas quitté son Marseille natal avant d’avoir mis ses boules dans sa valise. « Le jour où je suis arrivé à New York, j’ai donné un coup de téléphone au président [de La Boule] de l’époque », raconte-t-il.
Comme deux autres membres du club, Xavier Thibaud, a été sélectionné pour représenter les Etats-Unis aux championnats du monde de Pétanque qui se tiendront en Thaïlande à la rentrée.
La Boule New Yorkaise a beau être le meilleur club des Etats-Unis selon son président Eduardo Santos, les joueurs ne voient pas venir la compétition sans une certaine appréhension. «Mon grand espoir, c’est de ne pas être ridicule», confesse Xavier Thibaud. «Comparé avec les grandes nations au monde on est très, très loin».
« L’entraînement quasi-quotidien c’est ce qui fait la différence » mais en raison de l’hiver et du manque de terrain couvert, la saison New Yorkaise est courte. Malgré la gratuité des leçons en semaine, le pétanque reste mal connue et peu pratiquée. Il n’y a qu’une petite dizaine de cours à ce jours disséminés dans New York à Bryant Park, Washington Square, Queens et Brooklyn, où chaque année un tournoi marque le 14 juillet.
Pour populariser ce jeu si cher à son cœur, Xavier Thibaud a récemment demandé l’installation de terrains à Central Park, l’endroit même où jouaient autrefois les expatriés français. Il rêve d’enseigner la pétanque aux enfants et de monter à terme un programme éducatif autour du jeu provençal dans les quartiers défavorisés.
Envie de taquiner le cochonnet? N’hésitez pas à vous joindre aux leçons gratuites à Bryant Park du lundi au vendredi entre 11h30 et 14h00.
Retrouvez La Boule New Yorkaise ce dimanche 24 juin pour le Madagascar Open, grand tournoi de doubles à partir de 10 am à Bryant Park.
Surprise musicale
“L’idée c’est de faire de la composition instantanée” explique Sylvain Luc. L’inspiration est son maître. Pour l’ouverture du match des Mets en présence de Jack Lang au Shea Stadium ce mercredi soir , le français de 42 ans peut seulement dire que ce sera «quelque chose d’assez groove». Le suspens est le même pour son concert sur Broome St, jeudi soir.

Celui dont la musique est étiquettée tantôt “Jazz”, tantôt “World”, s’est découvert tres tôt un talent de compositeur. Né dans une famille de musiciens, Sylvain Luc compose à douze ans à peine. « C’était pas terrible franchement » dit-il aujourd’hui, « mais avec les années on se bonifie comme le bon vin ».
Après avoir étudié le violoncelle au conservatoire il aurait pu suivre une carrière de musique classique mais sa « soif de liberté » l’y fait renoncer. Sylvain Luc range son violoncelle dans sa boîte et choisit le chemin de la liberté : le Jazz. La première formation qu’il monte Bulle Quintet est lauréat du prix international de San Sebastian. Il a 17 ans.
« J’ai mis beaucoup de temps à décider d’entreprendre quelque chose autour de ma pomme » dit-il.
Sylvain Luc a en effet débuté sa carrière en tant qu’accompagnateur à Paris. Tantôt à la guitare, tantôt à la basse, le jeune bayonnais accompagne, compose et arrange pour des chanteurs tels que Benoît Cazenave, Georges Moustaki, Phillipe Léotard ou Romain Didier, tout en fréquentant assidûment les clubs de jazz.
En 1993, néammoins il sort de l’ombre et des rangs en enregistrant son premier album solo de guitare. Son titre Piai ou “voyage” en basque révèle aussi bien l’attachement de Sylvain Luc à ses origines qu’aux musiques folkoriques de tous horizons. « Je suis très curieux de toutes les musiques traditionnelles » dit-il. Muni de son « oreille de cannibale », il dit se «nourrir» du repertoire indonésien irlandais, andalous ou encore africain.
Ce ne sont là pourtant qu’une infime partie de ses influences. S’il chérit Bach, Ravel ou Keith Jarret, son « amour de la chanson » le pousse à reprendre et enrichir des thèmes d’Edith Piaf, Charles Trenet Paul Simon ou Stevie Wonder, entre autres. « Finalement je ne crée rien, je me sers » soutient-il.
La carrière de compositeur-improvisateur de Sylvain Luc prend un tournant décisif lorsqu’il décroche un contrat avec la maison de disques Dreyfus Jazz en 2000. Duet, le quatrième de ses 8 albums, gravé en duo avec le guitariste Bireli Lagrène s’est vendu à près de 70 000 exemplaires. Une performance pour un titre de Jazz.
Pour la troisième fois à New York et de retour en septembre Sylvain Luc rêve d’une tournée aux Etats-Unis mais reconnaît que « ce n’est pas de la musique très commeciale et très populaire».
Tout en continuant de jouer avec l’harmoniciste Olivier Kerourio ou dans les formations String Quartet et Trio Sud, il travaille d’abord à la promotion de son dernier album Joko enregistré avec le clarinettiste Michel Portale et le pianiste Jacky Terrasson. Un prochain est prévu pour bientôt, dont Sylvain Luc ne connaît pas l’exacte teneur, bien sûr.
Retrouvez Sylvain Luc à l’occasion de Make Music New York, jeudi 21 juin:
– Devant le restaurant L’Orange Bleue au 430 Broome St. de 6h à 8h
– Lors de la soirée des French Tuesdays