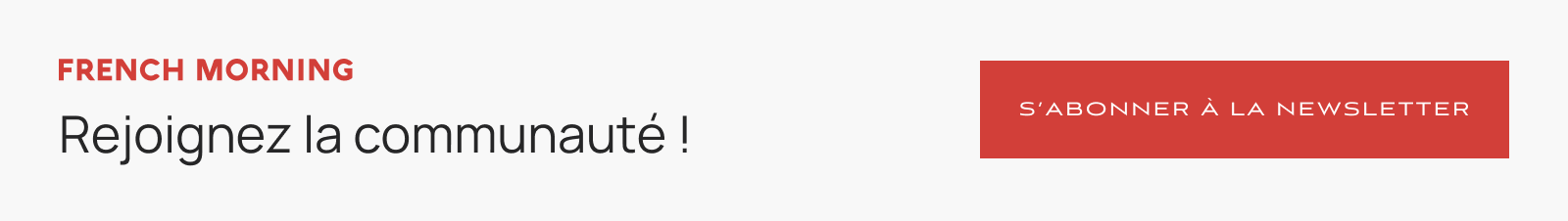Le cadre chic et le design épuré de la boutique ginette_ny sur West 4th Street contrastent avec les pubs et les sex shops voisins. Ouvert depuis un mois et demi, ce nouveau jelwery bar, au comptoir et panneaux en bois sombre, invite les amateurs de bijoux à une nouvelle expérience. Le nom ginette_ny représente bien l’esprit de la marque : un prénom vieillot du sud de la France, modernisé par la New York touch.
Derrière le bar, Frédérique Dessemond, la designer, s’adresse aux clients installés sur les tabourets en fer vintage, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. La shopping experience peut commencer. Elle leur propose un café– ou un verre de Bordeaux, selon l’heure. Objectif: que les client repartent avec l’impression d’avoir passé un moment entre amis.

Sentimental
Dans les vitrines sont exposés pendentifs, bracelets, et bagues, en or blanc ou jaune 14 carats. Frédérique Dessemond présente son produit phare: un disque plat épuré, attaché par une chaîne. Ginette_ny propose des bijoux vintage. La créatrice s’est inspiré des médailles traditionnelles, qu’elle a modernisé. Les clients peuvent faire graver dessus les noms, initiales ou mots de leur choix. « Je veux faire des bijoux à la mode mais personnalisés, pour que tout le monde n’ait pas le même» résume t-elle. Frédérique Dessemond insiste aussi sur le côté sentimental de la médaille : beaucoup de mères font graver les initiales de leurs enfants dessus et la considèrent comme un lien affectif. Les médailles version enfants existent aussi et connectent toute la famille.
Aux médailles s’ajoutent une autre ligne ludique : des médaillons de la taille d’un token – ces jetons que l’on utilisait avant les cartes métro- avec un mot gravé dessus. En les collectionnant, on finit avec un message autour du cou ou au poignet.
Frédérique Dessemond aime chiner et s’inspire d’objets vintage. Dans sa collection, elle revisite des fermoirs de montre qu’elle transforme en bracelet, ou tourne des marque-pages en pendentifs. « L{a plupart de mes clients n’ont jamais porté de bijoux} » remarque la créatrice. C’est pourquoi elle veut créer des « bijoux de tous les jours qui font partie de vous ».
Esprit d’entreprise
La créatrice s’est passionnée tôt pour l’art et le design. Elle a grandi à Marseille, dans un immeuble conçu par Le Corbusier. Elle étudie l’histoire de l’art et travaille comme décoratrice d’intérieur avant d’arriver à New York en 2000. Elle commence à créer des vêtements et des accessoires. Puis elle gagne une green card à la loterie et décide de rester. La ville stimule sa créativité et elle s’y sent bien.
Deux ans après, son disque séduit Calypso bijoux, alors en quête de nouveaux talents, et la voilà lancée. Ginette_ny voit le jour en septembre 2003. Encouragée par l’état d’esprit entreprenant et positif américain, créer une entreprise a été assez facile pour Frédérique Dessemond. « Ce que j’ai fait ici, je n’aurai jamais pu le faire en France » souligne t-elle. Ses bijoux sont alors vendus chez Calypso, puis chez Barney’s et Henri Bendel, mais aussi au Japon et en France, au Printemps et au Bon Marché, et depuis peu chez le bijoutier marseillais Frojo.
En parallèle, Frédérique Dessemond étoffe sa collection. A côté des disques, on trouve des bijoux ethniques, inspirés des bijoux berbères et même une panthère plate gracile, lovée sur elle-même, à porter en pendentif. Prochaine étape pour ginette_ny : une ligne de sacs.
ginette_ny
ginette_ny – Jelwery Bar
172 West 4th Street, between 6th Avenue & Jone St.
Bar à bijoux
Sondage: Sarko-What?
La question méritait d’être posée: que pensent les Américains de l’élection de Nicolas Sarkozy? Aura-t-elle des conséquences sur les relations transatlantiques? La French American Foundation a eu l’idée de commander un sondage sur la question. Bonne idée, sans doute, mais qui permet surtout d’avoir une confirmation: le sujet n’est pas précisément en tête des préoccupations des citoyens américains. A la question: “Quel effet aura la présidence de Nicolas Sarkozy sur les relations franco-américaines?”, ils sont 62 % à avouer qu’ils ne savent pas. Ceux qui émettent un avis pensent majoritairement que Sarkozy aura un effet positif (21% des sondés) ou qu’il sera sans effet (14 % des sondés).
Mais on aurait sans doute tort de voir dans cette perpléxité du désintérêt: 57 % des sondés affirment qu’ils font “des efforts” pour tenter de rester au courant de l’actualité politique européenne. Surtout, le sondage ne trahit aucun sentiment anti-français majeur. 80 % des personnes interrogées pensent en effet qu’ “il est important ou très important pour les Etats-Unis de maintenir une bonne relation avec la France dans les années à venir”. Détail qui réjouira les plus “rednecks”: le sentiment pro-français est quelque peu “girlie”. Les femmes sont plus nombreuses à juger la relation franco-américaine important: 83 % (contre 77 %) pour les homes.
Ce sondage a été effectué par téléphone du 11 au 13 mai auprès de 1 0004 Américains par Roper Public Affairs and Media.
Le "diplomate le plus populaire de Washington" à l'Elysée
“N’attendez aucun changement dans les principaux points de la politique étrangère française”: c’est que Jean-David Lévitte répétait deux jours avant l’élection de Nicolas Sarkozy devant le Chicago Council on Global Affairs. Apparemment il savait de quoi il parlait: c’est lui que le nouveau president de la République a chargé de mettre en musique la non-rupture qui devrait marquer sa politique étrangère.
Si Nicolas Sarkozy a beaucoup insisté sur le fait qu’il ne trouvait, notamment, rien à redire à la politique de Jacques Chirac face à la guerre en Irak, Lévitte symbolise parfaitement cette continuité Sarkozo-Chiraquienne. L’ancien ambassadeur à Washington retrouve en effet l’Elysée où il a déjà occupé les fonctions de conseiller diplomatique auprès du president sortant, entre 1995 et 2000.
Pour Jean-David Lévitte, 60 ans, le retour à la case départ peut apparaître décevant. Depuis plusieurs années, à chaque remaniement ministériel, il a été régulièrement évoqué comme ministrable possible. Mais quand vendredi dernier Nicolas Sarkozy a appelé l’ambassadeur à Washington pour lui demander d’être ce lundi à Paris, il lui a tout de suite dit de quoi il s’agissait: retour à l’Elysée. Retour exprès d’ailleurs: parti précipitamment, Jean-David Lévitte ne repassera pas par Washington. Il s’est, dès mardi, veille de la passation de pouvoirs, installé dans ses nouveaux bureaux du palais présidentiel. En revanche, il restera ambassadeur en titre jusqu’à l’arrivée de son successeur, ce qui lui permettra vraissemblablement de venir fêter le 14 juillet à Washington et y faire officiellement ses adieux.
Trésors de charme
Si le fond de la politique ne devrait guère changer, Nicolas Sarkozy choisit en revanche pour le conseiller un diplomate qui a beaucoup oeuvré à tenter de rapprocher France et Etats-Unis, notamment après le clash de 2003 et de la guerre en Irak. Il en a fait son combat, déployant des trésors de charme auprès des éditorialistes et autres relais d’opinion à Washington. Même les plus conservateurs et anti-français ont succombé, comme le Washington Times qui le qualifiait en février de “gentleman dont l’élégance nonchalante et les manières gracieuses en font un des diplomates les plus populaires et efficaces de la ville”. Depuis l’annonce de son départ, les services de l’ambassade de France sont assaillis de coups de fil de lamentation de ses interlocuteurs dans les médias qui, disent-ils, le regrettent déjà.
Pourtant, au moment du déclenchement de la guerre en Irak et de la vague de ‘French bashing’, l’ambassadeur avait d’abord choisi d’ignorer la poussée de fièvre, tout comme d’ailleurs les accusations d’anti-sémitisme français qui allaient suivre. Mais à partir de mai 2003, il décide de changer de tactique, en répondant coup pour coup aux attaques anti-françaises de la presse. Comprenant le rôle du Congrès, il y a poussé à la creation d’un ‘French caucus’ et embauché un lobbyiste.
Sa longue expérience des Etats-Unis lui a permis de s’y faire beaucoup d’amis. Il est invité à passer Thanksgiving chez Richard Holbrooke, l’ancien ambassadeur américain à l’ONU ou à regarder le superbowl avec Bill Clinton.
Mais il a aussi testé les limites de l’action diplomatique face au “French bashing” et fréquemment fait part de sa frustration à voir l’amélioration à Washington peiner à se propager auprès de l’Américain moyen. Pour tenter d’y remédier, l’ambassadeur a pris son bâton de pélerin ces dernières années, pour aller porter le message de l’amitié franco-américaine dans les Etats les plus reculés.
A la tête d’une équipe diplomatique renforcée (pour la première fois le conseiller diplomatique aura sous son autorité la cellule Afrique, privée donc de l’autonomie dont elle jouissait jusqu’alors), Jean-David Lévitte va désormais pouvoir utiliser tout son talent pour expliquer à ses interlocuteurs américains que leurs espoirs d’un spectaculaire changement de politique étrangère française seront sans doute déçus…
Anna Gavalda et le poireau de Flaubert
Dans les poches de sa veste, Anna Gavalda a des antisèches. Dans l’une, c’est un traducteur électronique. Dans l’autre ce sont des phrases indispensables qu’elle a demandé à son voisin d’avion (un architecte, comme le personnage de son prochain livre) de lui traduire parce qu’elle en était sûre d’en avoir besoin à New York. L’une est de Colette : «avec les mots de tout le monde, écrire comme personne». L’autre dit que les livres faciles à lire sont les plus difficiles à écrire.
Cette deuxième phrase, elle l’a employée chez Barnes and Noble. Jeudi soir, elle était invitée à la librairie d’Union Square pour un entretien croisé avec la chanteuse Rosie Thomas. La journaliste Katherine Lanpher qui anime le programme explique au public américain que le livre de Gavalda «Ensemble c’est tout» (Hunting and Gathering en anglais) s’est vendu à un demi million d’exemplaires en France, qu’il vient d’y être adapté au cinéma et a été traduit dans 36 pays. «She is hot, hot, hot !» A côté de l’élégante Anna Gavalda, Rosie Thomas a un look disons plus Seattle, des airs de petite fille et une barrette dans les cheveux. Elle a une voix aussi haut perchée que celle de Gavalda est grave et chante des jolies chansons folk, comme on aimerait en écouter pour les longues routes en voiture si on avait une voiture.
Katherine Lanpher décrit le vent d’optimisme qui souffle dans «Ensemble c’est tout». «Pourtant je suis quelqu’un de pessimiste », insiste Gavalda, avec un ton si grave que la salle en reste bouche ouverte. « Si c’est un challenge d’écrire une histoire d’amour ? » « Ca en est encore plus un d’en vivre une» répond-elle.
La romancière s’excuse de mal parler anglais (elle le parle très bien), elle reconnaît aimer écrire pour les gens qui n’aiment pas lire. Et ça ne veut pas dire que c’est plus facile, insiste t-elle. D’ailleurs, elle dit avoir plutôt plus de mal à écrire maintenant qu’elle a du succès, elle a peur d’avoir perdu de sa fraîcheur.
Interrogée sur ses auteurs américains préférés, elle cite Steinbeck qui peut tout écrire, des Raisins de la Colère à bâtir une histoire à partir de deux saoulards autour d’une bouteille de Whisky. Et votre amour pour Flaubert ? l’interroge Katherine Lanpher. «He is my chouchou», s’attendrit Gavalda qui n’a pas eu le temps d’utiliser son traducteur automatique. «Your petit chou ? Your little cabbage ?» essaie de traduire l’animatrice. « Disons que pour moi ce serait plutôt un poireau… », corrige la romancière. Elle n’a pas le temps de développer la comparaison, la salle glousse déjà. L’animatrice aussi. « Is there a double entendre ? » demande Gavalda. Hampher est morte de rire. L’écrivaine tente de s’en sortir en disant alors que Flaubert ce serait plutôt du céleri, mais du céleri branche… L’animatrice pliée de rire lui conseille de passer à autre chose.
Pas étonnant que Gavalda file aussi facilement les métaphores culinaires. Elle a passé beaucoup de temps à faire des recherches autour des fourneaux pour son dernier livre. Et elle aime les cuisines. «C’est là où se passent toutes les choses importantes dans une vie, là où se tiennent toutes les conversations importantes. »
Rosie Thomas, dont on avait entendu la voix qu’en chanson est d’accord. Son disque, These Friends of Mine, a aussi beaucoup mûri dans les cuisines de ses copains. Elle dit chanter les jours où la voiture ne démarre pas, le petit ami vient de rompre en disant que ça ne marchait pas et où on ne sait pas comment payer son loyer. Elle fait rire en racontant des histoires de son frère un peu loseur, représentant en produits pharmaceutiques. «Quand on montre sa vulnérabilité on est invulnérable», lui dit Anna Gavalda, manifestement sous le charme. Leurs routes vont se croiser. Le lendemain, la romancière ira signer des livres chez McNally Robinson sur Prince Street. Rosie Thomas prend l’avion pour l’Europe. Elle jouera au Bataclan le 22 mai. «Ca, je vais lui envoyer du monde », promet Anna Gavalda.
Sarkozy est-il le pro-américain qu'il paraît ?
Le nouveau président français « proclame ouvertement son amour d’Ernest Hemingway, de Steve Mcqueen et de Sylvester Stallone, son admiration pour l’éthique professionnelle américaine et il en croit en la mobilité sociale verticale » rapplle le New York Times. Il a pleuré en regardant le dernier film de Robert Altman, avait envie d’entendre «I will survive» en chant de victoire. C’était le candidat préféré de la Maison Blanche, qui « a dû être soulagée dimanche que le président bush n’ait pas à appeler Mme Royal pour la féliciter ». Les deux hommes se ressemblent, « impétueux, au parler musclé et fiers de ça ». D’ailleurs, observe le New York Times, parler de racaille dans les banlieues, c’était l’équivalent du « Bring’em on » (qu’on pourrait traduire par quelque chose comme « viens te battre! ») de Bush dans sa guerre contre le terrorisme. Les deux hommes ne boivent pas, courent et font du vélo… Et pourtant rien ne dit, au contraire même, que Sarkozy aurait eu une attitude différente de celle de Chirac face à la guerre en Irak.
Dans le même journal, Craig Smith met aussi en garde contre les trompe l’œil. Il ne faut pas, selon lui, se fier à l’ «une des images les plus frappantes » de la campagne française : «Nicolas Sarkozy sur un cheval blanc, l’air tout à fait Texan de prime abord». Ne pas y lire un rapprochement de Washington. «Là où les américains voient un cow-boy, les Français voient un gardian, le cavalier traditionnel de Camargue». Il explique que les positions de Sarkozy sur l’Irak n’étaient pas différentes de celles de Chirac, qu’il compte retirer des troupes françaises d’Afghanistan, appeler les américains à respecter les accords de Kyoto, est opposé à l’entrée de la Turquie dans l’Union Européenne…. Et même si Sarkozy a eu des mots durs face à l’Iran, « si Washington compte mettre sur pied une réponse militaire, il ne faudra pas compter sur son soutien ».
L’éditorialiste Jim Hoagland appelle aussi les lecteurs du Washington Post à se méfier de l’image atlantiste du prochain président français. « Ne vous attendez pas à ce que Sarkozy cherche immédiatement à démanteler la politique étrangère de Chirac cherchant à faire de l’Europe un contrepoids à l’influence américaine à l’étranger. Sarkozy est bien plus impressionné par ce que les Etats-Unis font chez eux que par ses objectifs globaux et sa présence internationale. Il voudrait imiter le dynamisme américain intérieur, pas les ambitions du gouvernement Bush à l’étranger ».
Les démocrates ont de quoi se réjouir de la victoire de la droite en France puisque, remarque E.J Dionne dans le Washington Post «la France et les Etats-Unis semblent sur des cycles électoraux opposés depuis la victoire de François Mitterand en 1981, un an après l’élection de Reagan». Plus sérieusement il cite un sondage d’Ipsos indiquant que 42% des électeurs de Royal disent avoir voté pour empêcher Sarkozy d’être président, alors que seulement 18 % des électeurs de Sarkozy votaient contre Royal. «La gauche est en difficultés quand ses campagnes s’appuient plus sur la peur de la droite que sur les espoirs que les progressistes inspirent».
Quelles conclusions en tirer pour Hillary Clinton. Aucune affirme l’Hillaryland au Washington Post. Leur candidate pour les présidentielles de 2008 maîtrise ses dossiers de politique étrangère, « à la différence de Royal qui mis en avant son charme et sa féminité plus que sa force en politique étrangère».
Alors que Chirac a reconnu le rôle de la France dans les déportations de la seconde guerre mondiale et l’esclavage africain, Sarkozy veut «se présenter comme un leader qui va de l’avant et pour qui s’excuser d’événements passés est un signe de faiblesse», note le New York Times. Il ne se repent pas non plus de ses vacances à Malte. « Contrairement aux autres dirigeants français, M. Sarkozy étale ses connections avec la classe financière et a critiqué l’inclinaison française à cacher sa richesse et son ambition ».
Sarkozy « a dit à ses concitoyens de se mettre au travail et a ensuite rapidement emmené sa famille en croisière sur le yacht d’un copain milliardaire » raconte le Washington Post. Le quotidien précise que la controverse qui s’en est suivie en France « ne porte pas sur les vacances – c’est un pays qui les révère » mais sur l’image d’excès.
Même pichenette de Maureen Dowd dans le New York Times. Dans son discours de victoire, Sarkozy « a dit qu’il « réhabiliterait » le travail et un conseiller a dit qu’il serait un « entrepreneur présidentiel » (dès qu’il rentrera de ses vacances sur son yacht). »
Sarkozy l’Américain, le vrai
Il est en fait le demi-frère du nouveau president de la République française, et leurs contacts ont été pendant longtemps des plus épisodiques. Oliver est le fils que Paul Sarkozy de Nagy-Bosca, a eu avec sa seconde femme, après avoir quitté son premier foyer alors que Nicolas avait 5 ans. Les deux hommes ont 15 ans d’écart.
Oliver est né en France, et s’appelait alors Pierre Olivier. Sa mère, Christine de Ganay avait épousé Paul Sarkozy qui allait bientôt à nouveau divorcer. Jusqu’à l’âge de 7 ans, Olivier vit à Paris avec sa mère et rencontre régulièrement ses trois demi-frères (Nicolas, Guillaume et François). Puis Christine de Ganay se remarie à son tour avec un Américain, Frank Wisner, un diplomate avec lequel la famille va alors voyager à travers le monde, de postes en postes. Franck Wisner (le beau-père d’Olivier -vous suivez toujours?) est aujourd’hui le représentant special des Etats-Unis au Kosovo.
Après une enfance voyageuse, Oliver intègre une “boarding school” britannique avant de poursuivre ses études en Grande-Bretagne. Il est diplômé d’histoire médiévale. Il entame ensuite sa carrière dans la banque d’investissement.
“Big bonuses”
UBS l’a “chassé” en 2002 chez Crédit Suisse First Boston. Depuis, Oliver (il a choisi d’américaniser son nom) est devenu une des stars du monde bancaire new-yorkais à seulement 37 ans, à la tête de la division “Financial Institutions Group”. Il y a supervisé quelques-unes des plus grosses fusions-acquisitions de banques aux Etats-Unis, notamment l’achat de MNBA par Bank of America pour 35 milliards de dollars.
La très “successful” carrière d’Oliver Sarkozy le met en tout cas à l’abri des cadeaux de milliardaires qui causent ces jours-ci des ennuis à son grand frère. En 2002, Credit Suisse avait tenté de le retenir avec un bonus de 4 millions de dollars (en plus d’un salaire de 3,5 millions de dollars). En vain: UBS avait fait mieux. Et depuis, les bonus se sont encore envolés, notamment l’an dernier. “En 2006, il a à coup sûr empoché un bonus qui se compte en dizaines de millions de dollars” estime un de ses collègues de Wall Street.
Coeur à gauche
Oliver Sarkozy habite l’ancien appartement du photographe Richard Avedon, acheté l’an dernier. Il est marié à une Française, Charlotte, avec laquelle il a eu deux enfants: Julien, 6 ans et Margot 4 ans. Tous deux sont scolarisés au Lycée Français de New York.
Lorsque son grand frère est venu en septembre dernier aux Etats-Unis, Oliver l’a fait profiter de son réseau étendu de relations en lui faisant rencontrer différentes personnalités du monde des affaires.
Aux Etats-Unis, nombreux sont ceux qui considèrent que le programme et les idées politiques du nouveau president français le placeraient du côté démocrate. L’orientation du petit frère semble confirmer: le coeur d’Oliver penche visiblement à gauche. Il donne régulièrement à des campagnes politiques, pour la plupart de candidats démocrates.
La grande prêtresse du foie gras
Un de mes amis journaliste avait rencontré Ariane Daguin. Je m’en suis souvenue avant d’aller la voir, je lui ai demandé ce qu’il savait d’elle, et j’ai reçu ce mail. « C’est en sortant de son “D’Artagnan” que j’ai pour le seule et unique fois de ma vie préféré laisser la moto au parking. J’ai rampé jusqu’à un taxi, dans lequel j’ai rampé avant d’hésiter sur mon adresse. Avant çà, on avait fait une séance de “rameurs”, assis par terre à la queue-leu-leu, les uns encastrés dans les autres, en slip, devant le bar du restau. » Quatre ans plus tard, au restaurant Frank dans le Chelsea Market, je trouvais Ariane Daguin face à une file de gens assis par terre, à la queue-leue-leue en train de ramer au son d’un groupe de bandas, Ariane donnant le tempo.
C’était Dimanche dernier. On couronnait les gagnants de son Duckathlon, un rallye qu’elle a lancé à New York, inspirée par le marathon des Leveurs de coude parisiens. « Eux, c’est plutôt un truc pour boire. Moi j’ai voulu insister sur la gastronomie. » dit-elle. La gastronomie dans son sens large à juger les épreuves organisées dans les restaus du Meatpacking : siffler des verres chez Jarnac pour reconnaître lequel ne contient pas d’Armagnac, faire le tour de la table de la cuisine en palmes, manger du steak chez Craft et deviner quel bœuf a été nourri à l’herbe… La plupart des équipes sont composées des cuistos des meilleures tables de la ville : Picholine, Chanterelle, le Bernardin…
Dans la salle du restaurant Frank’s où se tient la remise des prix, plusieurs personnes portent des badges « cancanez si vous aimez le foie gras ». Une équipe s’est choisie des t-shirts imprimés de pattes de canards avec un slogan « got foie gras ? » Car Astérix à l’accent gascon, c’est Ariane Daguin, une Française qui défend la citadelle du foie gras depuis que des associations de protection des animaux tentent d’en faire bannir la vente, voir la production, aux Etats-Unis.
Ariane et le foie gras, c’est une longue histoire. Née d’une famille de restaurateurs depuis huit générations, elle a failli quitter les rails. Fille du chef André Daguin, elle était venue faire des études de journalisme à Columbia. A New York, elle a travaillé à la charcuterie des Trois Petits Cochons, d’abord à temps partiel, puis à en oublier de finir ses études. Un jour, un type a poussé la porte avec un foie gras. « Je ne pouvais laisser passer ce moment historique », raconte t-elle encore émue. Elle a tenté d’expliquer à ses employeurs qu’il était indispensable de rajouter le foie gras à leurs spécialités. Ils n’ont pas osé. Ariane a suivi le foie gras, et a monté D’Artagnan, premier distributeur de foie gras aux Etats-Unis.
C’était il y a 22 ans. Aujourd’hui, son entreprise est installée à Newark («pour être prêt de l’aéroport»), et elle tourne à bloc (de foie gras). Ariane a même installé une douche dans son bureau, qu’à Noël dernier elle n’a pas quitté pendant cinq jours et cinq nuits.
Et curieusement pour quelqu’un qui peut passer la nuit au bureau, elle a aussi d’autres activités. On ne s’étendra pas sur les cours de saxo (pour apprendre à jouer l’air sur lequel on fait du rameur assis par terre), les tournois de belotes, le militantisme pour l’ouverture d’un terrain de pétanque à Central Park (oui, elle aussi a remarqué comment les expats peuvent devenir plus français que les Français), la présidence de « l’association des nouvelles mères cuisinières » (une association de femmes chefs)… Elle a surtout pris la tête de l’Artisan Farmers Alliance, une association de producteurs de foie gras. Leurs méthodes n’ont rien d’artisanal. Ils ont embauché un lobbyiste à Washington et s’emploient à « éteindre des feux » quand des projets de législation visant à interdire le foie gras apparaissent du Connecticut à la Californie … « Sur le plan législatif, on gagne » explique t-elle. Elle attend, optimiste le verdict du procès que l’association a intenté à la ville de Chicago qui a interdit le foie gras. « Quand même Chicago la capitale des abattoirs… »
Du point de vue de l’opinion publique, le bilan est plus mitigé. Elle s’inquiète de l’impact des campagnes anti foie gras auprès de l’opinion. Le camp d’en face (les associations Peta et HSUS) dispose, selon elle, d’un budget annuel de 200 millions de dollars et surtout de la circulation d’une horrible vidéo de gavage (« ça a dû être tourné à Madagascar »). Ariane Daguin est assez convaincante quand elle explique que le métabolisme du canard le prédispose à faire du foie gras et que ses producteurs sont victimes d’une injustice (« et on ne parle pas des conditions de transport du homard »). Elle s’agace aussi à l’idée que les groupes de défense des animaux mettent le foie gras dans le même sac que le porc et le veau de batterie. « Ca fait 22 ans que je me bats pour les produits organiques aux Etats-Unis et je me retrouve dans le rôle du méchant…. »
Revers de la campagne, le foie gras jusque là inconnu du grand public y a gagné en visibilité ; A Chicago, une ville qui s’y connaît en matière de lutte contre la prohibition, l’interdiction du foie gras a poussé les libertaires à en mettre partout. Jusqu’à un vendeur de hot-dog qui en sert une recette au foie gras. Il a pris une amende de 250 dollars. Probablement les 250 dollars les mieux investis selon Ariane, « il a eu quatorze télés chez lui ». Inutile de dire que le marchand de hot-dogs au foie gras est depuis un client de D’Artagnan. Ce que pense Ariane Daguin de cette manière de l’accommoder ? Je lui dis en avoir récemment goûté en donuts au restaurant Fireside. Elle ne trouve rien à y redire : c’est une femme qui préfère l’excès de créativité aux brides traditionalistes trop serrées.
Poiret, "roi de la mode" au MET
François-Henri Pinault (patron de PPR, propriétaire de la FNAC, la Redoute, Gucci,etc et heureux fiancé de l’actrice Salma Hayek), l’actrice Cate Blanchett, Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Balenciaga et Anna Wintour, la puissante rédactrice en chef du Vogue américain, ont inauguré ce lundi 7 mai une importante rétrospective du travail de ce couturier de génie au Metropolitan Museum of Art (MET) de New York.
Reconnu pour son génie de drapier, le grand couturier révolutionne l’habillement féminin au tournant du 20ème siècle et jusque dans les années 30, en l’affranchissant du corset, des jupes à baleines et des fanfreluches qui opprimaient le corps des dames de l’époque. Poiret dessine des tenues souples (qui font parfois scandales), inspirées entre autres de l’Orient, du fauvisme et des ballets russes.
Certains costumes, acquis par le MET lors de la vente aux enchères de la collection privée de la famille Poiret en 2005, seront montrés pour la première fois au public.
Du 9 mai au 7 août 2007
Metropolitan Museum of Art
1000 Fifth Avenue, New York, New York 10028.
Entrée : 20 dollars.
Tous les résultats des Etats-Unis
Ensemble des Etats-Unis
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
|74 611| 36,40% |63,69% |36,31%|
Résultats consulat par consulat:
Consulat d’Atlanta:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
| 3 213 | 35,48%| 65,8% |34,2%|
Consulat de Boston:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
|3 914 |41,65%| 53,4% |46,6%|
Consulat de Chicago:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
|4 394 | 33,55% | 62,4% |37,6%|
Consulat de Houston:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
| 3 930 | 34,38% |72,2% |27,8%|
Consulat de New Orleans:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
|565 | 34,69% | 49,2% |50,8% |
Consulat de Los Angeles:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
|12 665 | 27,11%| 63,8% |36,2%|
Consulat de Miami:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
| 6 887| 28,40% | 81,7% |18,3% |
Consulat de New York:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
| 18 400| 43,15% | 65,2%| 34,8%|
Consulat de San Francisco:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
|12 204| 37,15% | 56,2%| 43,8%|
Consulat de Washington:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
|8 439| 41,57% | 61,8% |38,2%|
Au Canada:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
|46330| 44,2%|46,1%|53,9% |
En Amérique Centrale et du Sud:
Mexique:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
|9815| 36,5% | 56,7% | 43,3% |
Argentine:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
|11630 | 22,2% |49,7% | 50,3% |
Brésil:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
|10887 | 33,5 % |54,5% | 45,5% |
Chili:
|Inscrits|Participation|Sarkozy|Royal|
| 6281 | 45,3% |59,6% | 40,4% |
Sarkozy à 65%
La participation sur les 9 bureaux de vote ouverts par le consulat de New York (8 à New York et un à Princeton) atteint 43,15 %. Ce score est nettement moins élevé qu’en métropole, mais c’est plus qu’à l’ordinaire à New York. Par rapport au premier tour (39,1 %), la participation a même progressé. New York a en cela suivi la même tendance qu’en métropole.
Nicolas Sarkozy (52,1 % au 1er tour) atteint 65,19 %; Ségolène Royale (22,9 % au 1er tour) est à 34,81 %.
Au vu des résultats du 1er tour, ce score de Sarkozy n’est pas surprenant et ne peut guère être extrapolé pour prévoir les résultats nationaux. En revanche, il donne des indications intéressantes quant au report des voix de François Bayrou; indications qui peuvent elles donner des tendances sur le comportement des électeurs au niveau national.
Au 1er tour à New York, François Bayrou avait engrangé 18,8 % des voix, soit 1360 voix. Les candidats du deuxième tour se sont partagé ces voix avec semble-t-il un avantage à Nicolas Sarkozy: il progresse entre les deux tours de 1328 voix, Ségolène Royal gagnant elle 1065 voix.
Les résultats définitifs à New York
Inscrits : 18400
Votants : 7940
Participation : 43.15 %
Nuls = 114
Exprimés = 7828
Sarkozy : 5103 = 65,19 %
Royal : 2725 = 34,81 %
Dernière ligne droite
« Les élections américaines de 2008 gagneraient à avoir un goût de France ». C’est écrit dans un éditorial de USA Today « Les Américains auraient des raisons d’envier – oserions nous dire « d’imiter » ? – certains aspects de la campagne » présidentielle française. » Parmi ses raisons : une participation à 84% (« contre 64 % en 2004 aux Etats-Unis »), une première candidate à la présidentielle (« même si Hillary Clinton pourrait la talonner de près »), la qualité du débat regardé par la moitié de la population française en âge de voter (« contre moins de 30 % pour le débat Bush Kerry »), et une « vraie différence » entre les candidats (« Sarkozy défend un traitement de choc un peu similaire à celui que Margaret Thatcher avait appliqué à la Grande-Bretagne » alors que Royal défendrait « les avantages sociaux du berceau à la tombe et les droits des employés, des politiques dont la France a de moins en moins les moyens »).
L’éditorial du Washington Post indique aussi une préférence pour Nicolas Sarkozy. Il serait « plus susceptible d’entreprendre les réformes économiques dont la France a désespérément besoin » veut croire l’édito qui rappelle, comme l’a fait celui de USA Today, qu’en 25 ans le PNB par tête français a chuté de la 7ème à la 17ème place dans le monde. « Sarkozy en comprend les raisons » selon l’éditorialiste du Washington Post alors que « Madame Royal a fait clairement comprendre qu’elle ferait empirer la sclérose ».
La préférence pour Sarkozy serait partagée dans la capitale américaine. « Ce n’est pas souvent que les politiciens américains ont un clair favori dans une élection présidentielle française » insiste l’édito. « Souvent le candidat le plus digeste est quelqu’un comme le président sortant Jacques Chirac qui définit sa politique en étrangère en opposition à celle des Etats-Unis ». Ce serait pour le Washington Post dans « ce moule » que se serait coulée Ségolène Royal. Alors que Nicolas Sarkozy « admire ouvertement les Etats-Unis ».
L’éditorial du Los Angeles Times compare aussi l’américanophilie supposée des deux candidats. Mais malgré l’image pro-américaine de Sarkozy, « ce serait une erreur de s’attendre à ce que la France soit plus alignée sur les Etats-Unis sous Sarkozy ». Car, rappelle l’éditorial, «comme presque tous les hommes politiques français, il était profondément opposé à la politique de la Maison Blanche en Irak et est favorable à un retrait des troupes françaises d’Afghanistan, ce qui pourrait bientôt s’avérer dangereux». Quant aux échanges commerciaux, « les deux candidats sont foncièrement français, c’est-à-dire protectionnistes ».
De toute façon, analyse Elaine Sciolino dans le New York Times, la politique étrangère n’a pas été un enjeu de ces élections. « Parfois les candidats avaient plus l’air de participer à une élection locale que de briguer la présidence d’une puissance nucléaire à la sixième économie mondiale. L’Irak et la relation de la France avec les Etats-Unis n’ont par exemple jamais été mentionnés » dans le débat. Ses extraits du débat sont gratinés. (« Non » répond t-elle. « Ah » dit-il.) «Leur ton faisait penser à un couple se chipotant à la table du petit déjeuner, avec le mari contenant mal son sentiment de supériorité et la femme l’attaquant parce qu’il n’écoute pas ».
Enfin pour ceux qui manquent encore d’informations sur les candidats, le New York Times publie en une un article consacré aux relations compliquées de Sarkozy aux immigrants. Le « possible prochain président » est « le fils d’un immigrant au nom pas très français qui a fait beaucoup, pour ne pas dire plus que n’importe quel autre responsable français pour améliorer le statut des minorités ». Il a même « défendu la discrimination positive à l’américaine, une hérésie pour beaucoup dans une France officiellement égalitaire et aveugle à la couleur de la peau ». Pourtant il est même persona non grata dans les banlieues, où son style a fait de lui « un ennemi pour beaucoup de jeunes minorités ».
Le Los Angeles Times consacre un article à Ségolène Royal. On l’a dite « froide », « autoritaire », « ambitieuse », « sans contenu »… et « tout cela venant de ses amis de gauche ». Mais cela ne nuit pas forcément à un candidat pro-changement de se faire allumer par l’establishment, fait valoir le quotidien.
« Son programme est un amalgame compliqué de gauche (35 milliards de nouvelles dépenses publiques), de droite (service militaire obligatoire pour les délinquants) et de centre (les étudiants seraient payés mais devraient enseigner). Son message est plus simple : la politique ça doit être souple. Et avec une mère courageuse au bon sens pratique à la tête du pays, tout se passera bien. Elle n’a ni grande vision historique, ni programme économique cohérent qu’on puisse résumer sur un autocollant. Ce qu’elle a, c’est une image de rupture avec le passé ».
Les Français ont effectivement besoin qu’on leur remonte le moral, insiste le Los Angeles Times « un sondage montrait la semaine dernière que les Allemands, les Italiens et les Espagnols ont tous une meilleure image de la France et de ses habitants que les Français ont d’eux et de leur pays ».