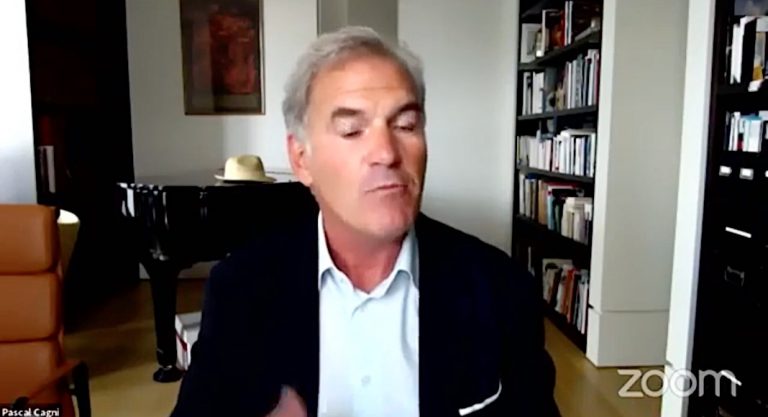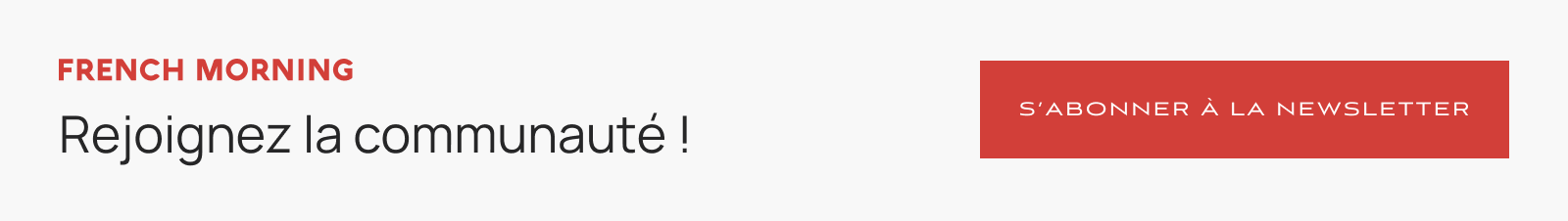Après plus de 10 ans à tourner dans les marchés locaux et les festivals de Californie, Rebecca et Djamel Dahmani ouvrent leur crêperie française à Berkeley, à l’Est de la Baie de San Francisco. Un véritable aboutissement pour ce couple de restaurateurs franco-américain. « C’était notre rêve d’avoir un espace rien qu’à nous et de pouvoir faire voyager les gens avec notre cuisine » confie Rebecca Dahmani.
Située à quelques pas du campus de l’Université de Berkeley, « La crêpe à moi » mise sur le savoir-faire français. « Je fais mes crêpes comme je les faisais à Paris, avec une recette secrète qui a fait ses preuves et circule de bouche à oreille entre crêpiers » explique Djamel Dahmani, surnommé Dj. Et d’ajouter avec fierté : « nous sommes des ambassadeurs de la France. Généreux dans nos assiettes et respectueux des traditions comme des ingrédients ».
Au menu, la simplicité prime. Tout est frais, les galettes sont à base de farine de blé noir et les ingrédients sont bios. « On veut honorer l’histoire de la cuisine et les produits des marchés locaux » assure Rebecca Dahmani. On trouve ainsi des galettes classiques comme la fameuse jambon/fromage (« la Parisienne »), la complète ou la quatre fromages, et des galettes aux touches plus californiennes, comme celle avec des pousses d’épinard ou la végétarienne. Côté sucré, l’incontournable crêpe beurre/sucre côtoie celles au citron ou aux fraises. Le tout à des prix abordables, allant de 5$ à 11$.
De la crise des subprimes au coronavirus, même pas peur
Si le couple a ouvert les portes de ce premier restaurant le 23 mai dernier, côté crêpes ce n’est pas un premier coup d’essai. « J’ai fait mes premières crêpes dans les années 90 à Paris ! » s’amuse Dj. Si ce dernier a passé de nombreuses années en crêperies parisiennes, il a également travaillé dans de nombreux restaurants réputés de la capitale. En salle comme en cuisine. En 2000, alors qu’il est manager d’un bistrot du 11ème arrondissement parisien, il rencontre Rebecca, jeune fille au pair américaine en stage dans l’hôtellerie. Jusqu’en 2006, le couple vit à Paris et fait ses armes dans le milieu de la restauration.
Fin 2006, pour des raisons familiales, Rebecca et Djamel Dahmani s’installent en Californie. Ils y découvrent alors la restauration dans de grands restaurants locaux, du côté de Sonoma County. Mais la crise des subprimes vient tout bouleverser. « Les restos dans lesquels on travaillait fermaient les uns après les autres » raconte Dj.
Dans un contexte de crise économique sans précédent, le couple décide alors d’être proactif et de lancer son business. « En 2009, on était à un Festival du 4 juillet et il n’y avait pas de crêpes. On s’est amusé au petit jeu « imagine que… » et c’est comme ça que “La crêpe à moi” est née » explique Rebecca Dahmani. « On a commencé par louer des cuisines commerciales pour faire des évènements en Californie, puis peu à peu on s’est équipés, on a investi dans un camion et on s’est concentrés sur les marchés » complète Dj.
Aujourd’hui, « La crêpe à moi » reste présente sur certains marchés, celui de Moraga ou de Kensington par exemple (cf. infos pratiques). De quoi maintenir des ventes en pleine crise liée à la Covid-19. « Heureusement que l’on continue les marchés le samedi car après un an de travaux dans le restaurant, on s’apprêtait à ouvrir quand le coronavirus nous en a empêché. C’était un coup dur, mais on n’a pas baissé les bras et on se bat au quotidien…» explique Rebecca Dahmani.
En attendant de pouvoir accueillir les clients en salle, les restaurateurs proposent donc leurs crêpes à emporter. Et ils gardent patience et humour. « On a lancé notre crêperie en pleine crise des subprimes, alors ouvrir notre restaurant en plein coronavirus, ça ne nous fait pas peur ! » sourit Dj. Ils attendent ainsi que la situation évolue pour étoffer leur carte, installer des tables dehors ou proposer des soirées spéciales. D’ici là, le menu est en ligne pour les gourmands qui veulent se régaler.









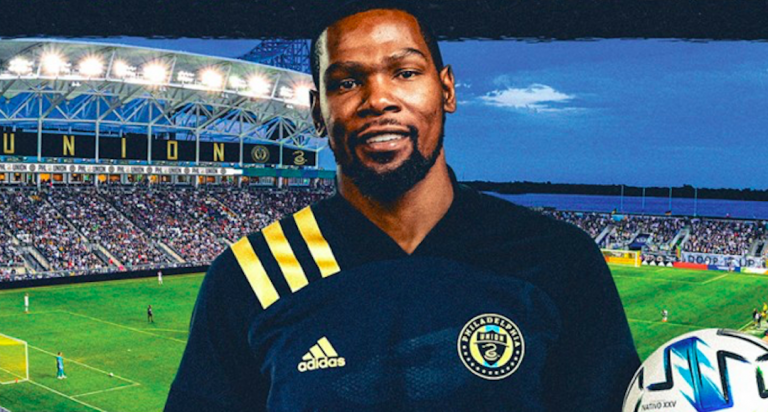

![[Replay] Suspension des visas: les réponses à vos questions sur La Bande FM [Replay] Suspension des visas: les réponses à vos questions sur La Bande FM](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2020/06/Bande-FM-Visas-768x417.jpg)