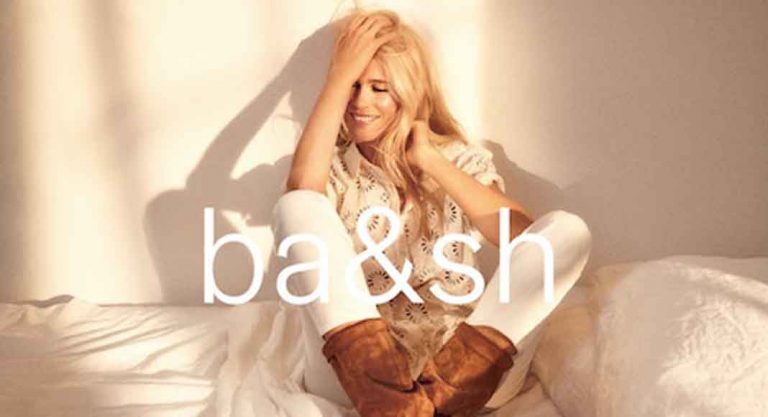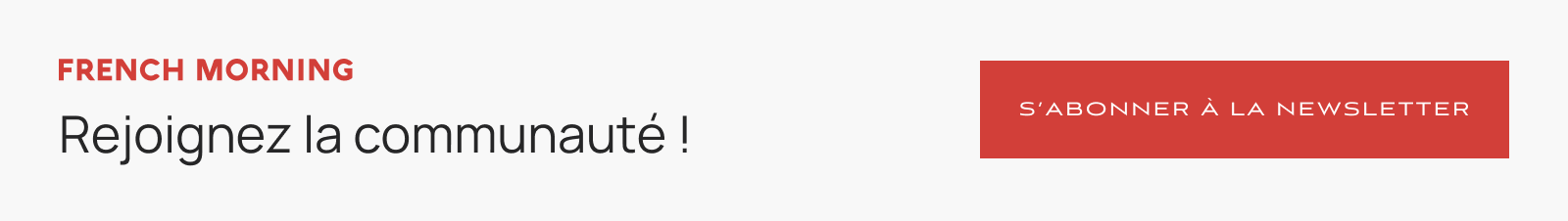Dorothée Pierrard brandit un petit récipient de verre rempli de détritus. C’est l’ensemble des déchets qu’elle a produits en “trois semaines-un mois“. “Sur un an, ça nous fait un gros sachet noir“, indique cette Versaillaise qui habite à Harlem avec son mari et son chat (qui n’a pas de nom).
Cette adepte du zéro déchet participera, jeudi 9 mai, à une discussion à Harlem sur comment agir au niveau local contre le changement climatique. Elle sera accompagnée du sénateur d’Etat Robert Jackson, d’un responsable de l’association de justice environnementale WE ACT et d’un chercheur de l’université Columbia. La conversation suivra la projection du documentaire à succès “Demain”, qui met en avant des initiatives dans le monde pour limiter le bouleversement climatique. L’événement est organisé par Uptown Flicks en partenariat avec French Morning.
En France, Dorothée Pierrard l’admet: “je n’étais pas écologiste”. Elle l’est devenue en s’installant à New York en 2006. “L’utilisation des doubles sacs plastiques au supermarché m’a choquée. Je me battais avec les baggers aux caisses. Je venais avec mon sac à dos en essayant d’aller plus vite qu’eux“.
Elle profite d’une période sans visa de travail pour voir comment elle peut réaliser des économies. Elle découvre le zéro déchet à travers la Française Béa Johnson, apôtre de ce mouvement et auteure du livre à succès Zero Waste Home. En 2015, elle s’investit dans la coalition Bag it NYC, qui milite pour l’interdiction de sacs plastiques à usage unique (finalement ratifiée par le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo fin avril). Son arme: son compte instagram, I spy a bag, où elle poste des photos de sacs plastiques prises dans toute la ville. Ce n’est pas la matière qui manque. “J’en ai fait 1.500 en quatre-cinq mois, dit-elle. Instagram me bloquait car j’en mettais trop“.
Chez elle aussi, elle se convertit. Exit le gel douche et son emballage plastique au profit du savon. Adieu les serviettes en papier et bonjour le tissu. Côté nourriture, elle se rend au marché ou à Whole Foods, où elle peut remplir ses bocaux en verre d’aliments en vrac. Aujourd’hui, dans son appartement de Harlem, il n’y a guère que les conserves pour son chat qui sont sources de déchets. Les seuls sacs plastique qu’on y trouve ont été réutilisés pour faire une lampe de chevet. “On dit que le zéro déchet est plus cher, mais au final ce n’est pas le cas“, souligne la Française, qui égrène volontiers les avantages de la pratique – “moins de tensions dans le couple liées au rangement, moins de temps à faire du ménage… Et il y a beaucoup de choses jetables que l’on achète sans réfléchir: le liquide vaisselle, les rouleaux d’essuie-tout, les produits hygiéniques pour les femmes. Ça coûte des sous“.
Dorothée Pierrard a une autre motivation: aider les habitants des quartiers pauvres de Queens et du Bronx où elle se rend pour son travail d’instructrice de locomotion pour non-voyants. Les populations les plus défavorisées sont celles qui paient le plus lourd tribut sanitaire à la pollution, que ce soit parce qu’elle se trouvent à proximité de centres de traitement de déchets ou le long d’axes empruntés par les camions qui transportent les ordures. “On peut penser que je suis une écologiste radicale. Je le suis pour le social. Ça me tue de me dire que les déchets que je produis vont dans les quartiers défavorisés où je travaille“.
Dans sa quête du zéro déchet, la Française a fait des convertis. Mais elle ne veut pas s’arrêter là. Son objectif: faire de l’activisme à travers l’art (photographie, dessin, sculpture…) pour “faire de ce qui m’attriste, comme les déchets, des choses positives“. Elle a notamment réalisé l’an dernier un arbre à base de sacs plastiques à Washington Square Park. “Par rapport à la réalité du changement climatique aujourd’hui, je ne considère pas avoir fait un changement de vie radical. Ce n’est pas qu’en utilisant des bocaux qu’on va y arriver. Il faut changer notre conception de vouloir toujours plus”.
Dorothée Pierrard, une Française dans le zéro déchet à New York
Notre-Dame de Paris: "L'enjeu est de faire durer la passion pour la cathédrale"
C’était bien avant le 15 avril 2019; bien avant l’émotion planétaire et Notre-Dame de Paris qui brûle en streaming… Depuis plus de trois ans, Michel Picaud, président de la fondation Friends of Notre-Dame de Paris, consacrait l’essentiel de son temps à tenter de lever de l’argent pour restaurer la cathédrale “qui était très dégradée par endroit”.
“J’ai entendu toutes sortes d’excuses, notamment de la part de grandes entreprises et fondations françaises qui me disaient “on ne peut pas donner pour une église; la France est un pays laïque, ça nous sera reproché”. Aujourd’hui, les mêmes annoncent qu’ils vont donner des dizaines de millions de dollars!”. Mais Michel Picaud n’est pourtant pas amer: “même s’il a fallu l’incendie, c’est formidable de voir cette passion des gens pour la cathédrale. On aura besoin de toutes ces nouvelles bonnes volontés pour reconstruire et notamment de ce côté-ci de l’Atlantique, où les Américains comprennent sans doute mieux que les Français qu’il faudra durer au-delà de cette flambée d’emotion”.
C’est avec les donateurs américains en tête que la fondation Friends of Notre Dame a été créée, il y a deux ans. L’idée est venue d’un professeur d’histoire de l’art américain, Andrew Talon, qui a suggéré au Cardinal Vingt-Trois, alors archevêque de Paris, de faire appel aux dons pour restaurer la cathédrale alors que la participation de l’Etat, propriétaire de la cathédrale, était largement insuffisante. Michel Picaud devient alors président bénévole de la nouvelle fondation et, fort de son expérience d’ex-dirigeant d’entreprises internationales, part à la conquête des philanthropes américains. “Dès la première année pleine, en 2018, nous avons collecté 3,2 millions d’euros en tout, dont la moitié aux Etats-Unis, auprès de 700 donateurs”.
Cette somme avait permis de lancer le plan de rénovation, qui devait s’étaler sur dix ans et, en cumulant dons privés et dotation de l’Etat, permettre d’investir 150 millions de dollars. “Depuis le 15 avril, l’ordre de grandeur a totalement changé”, note Michel Picaud. Rien qu’aux Etats-Unis, les 700 donateurs sont devenus 10.000 en deux semaines. Avec les méga-dons annoncés en France, le presque milliard de dollars déjà promis devrait permettre de reconstruire la cathédrale sans difficulté, “mais l’enjeu, maintenant, c’est de faire durer cette passion retrouvée pour l’édifice, car au-delà de la reconstruction il faudra ensuite assurer l’entretien et les rénovations qui doivent être faites en permanence. Idéalement, c’est un milliard de dollars supplémentaire qu’il faudrait lever pour créer un capital (“endowment”)”.
C’est la raison pour laquelle Michel Picaud est venu début mai aux Etats-Unis, et qu’il rencontre tous les potentiels donateurs. Certains, impressionnés par l’ampleur des dons des milliardaires et grandes entreprises françaises, se demandent si la cathédrale a encore besoin de leurs dollars. “Mais ils comprennent très bien quand je leur explique l’enjeu de long terme, l’entretien”. Et puis, grâce à cette émotion provoquée par l’incendie, “les portes s’ouvrent plus facilement, on est reçu partout. Mon rôle, en ce moment, c’est d’entretenir cette flamme, d’expliquer le rôle de la fondation à ces Américains qui sont sensibles à la cause, mais veulent aussi des garanties sur l’efficacité et l’usage des fonds”. Et là, ajoute le président bénévole, la Fondation a des atouts: “nous n’avons pratiquement pas de coûts de fonctionnement. L’équipe de fundraising de Notre-Dame, vous l’avez devant vous au grand complet”, dit-il parlant de lui et d’André Finot, chargé de la communication de Notre-Dame, qui l’accompagne dans son voyage américain.
Pour ne pas perdre de temps, la fondation va multiplier dans les prochains mois les évènements de fundraising aux Etats-Unis, par exemple à Boston début juin et à New York, chez Christie’s les 4 et 5 juin où les riches clients de la maison d’enchères vont être mis à contribution. Viendront ensuite Washington et Chicago. “Et partout, le fait que nous ayons maintenant 10.000 donneurs actifs, et plus seulement 700, va être un atout formidable à long terme”. Tout comme le volontarisme affiché en France pour le lancement du chantier. “Il y a déjà 130 ouvriers qui travaillent 7 jours sur 7, et il y en aura 300 à partir de juillet”.
5 jobs aux Etats-Unis que les Français ne comprennent pas
En 2018, l’anthropologue David Graeber avait publié Bullshit Jobs: A Theory sur ces d’emplois sans signification. Et comme il le montre, les Etats-Unis sont les spécialistes du “bullshit job”, le boulot à la c**. En voici quelques-uns.
Le busboy dans la restauration
Lors d’un passage dans un restaurant, on a souvent l’impression de parler à 3 ou 4 personnes différentes. Entre les hôtes et les hôtesses, le serveur ou la serveuse et les fameux busboys, une armée de bras se forme autour des clients. Le busboy, c’est celui qui vient remplir vos verres d’eau ou vos tasses de café, alors qu’en France, on aurait davantage l’habitude d’avoir le serveur ou la serveuse faire ce travail. Souvent, il doit aussi débarrasser les couverts et emmène la vaisselle au plongeur.
Le “bagger” dans les supermarchés
Quand on a vécu en France, on a des années d’entrainement quand il s’agit de mettre les courses dans nos sacs (recyclables évidemment). Déception donc, aux Etats-Unis, quand il est impossible de montrer notre talent d’emballeur. Souvent, ces emplois sont tenus par des jeunes lycéens ou des retraités cherchant à arrondir leurs fins de mois. Tous les supermarchés n’ont plus forcément de “baggers”, un travail qui se retrouve souvent sur les épaules de la caissière, sauf si on lui dit que l’on peut le faire pour la dépanner.
Le “gas jockey” aux stations-services
On les retrouve surtout dans le New Jersey, le dernier État qui interdit que l’on fasse le plein soi-même. Jusqu’en janvier 2018, l’Oregon faisait aussi partie de ce club qui date des années 70. Dorénavant, les stations-services dans les comtés de moins de 40.000 habitants n’ont pas l’obligation d’avoir un employé pour faire son plein. La bienséance veut que l’on laisse à “tip” à la fin de ce service indispensable…
Les “greeters” de Walmart
Un employé du supermarché Walmart dont le rôle est d’attendre devant la porte d’un magasin et de dire “bonjour” chaleureusement à tous les clients qui entrent. Le fondateur de la marque, Sam Walton, a mis en place cet emploi au niveau national dans les années 1980. En février dernier, Walmart a annoncé la fin des “greeters” dans leur magasin pour être remplacés, depuis avril, par des “hôtes de clients” dans 1.000 magasins. Pour ce poste, les employés devront aider les clients à trouver des produits.
Le “restroom attendant” dans les toilettes
Vous vous rendez aux toilettes du restaurant et, surprise, vous n’êtes pas seul. Certains restaurants ou boites de nuit emploient des “restroom attendants”, un employé chargé de s’assurer que les toilettes sont propres et qu’il y a assez de papier ou de savon pour les usagers. Parfois, ils activent le robinet pour vous ou donnent du savon. Pensez à leur laisser un pourboire avant de partir.
Hélène Leroux, profession "doodler" chez Google
Vous êtes-vous déjà demandé qui était derrière ces petites illustrations (des “doodles”) qui viennent régulièrement se greffer sur la page d’accueil de Google, en détournant le logo du moteur de recherche ? Nous non plus, jusqu’à ce qu’on rencontre Hélène Leroux. Cette Française de San Francisco est une “doodler”.
Chaque jour, ses dessins, animations ou jeux vidéos, sont vus par des millions d’internautes. Objectif : mettre en avant des évènements positifs pour l’humanité comme des anniversaires artistiques, scientifiques ou de personnalités. « Quand je travaille sur un sujet, je commence par faire des recherches puis je l’interprète selon mon inspiration. Je réalise alors des esquisses qui évoluent avec les retours de mes collaborateurs » explique la jeune femme de 31 ans.
Le processus prend un mois de travail en moyenne pour une simple illustration et pas loin d’un an pour un jeu vidéo ou une animation complexe. « On travaille plutôt en solo mais par exemple pour l’hommage au réalisateur français George Méliès, j’ai collaboré avec une trentaine de personnes pour produire un film en réalité virtuelle » précise l’artiste avant d’ajouter avec passion : « c’est très stimulant de découvrir l’aspect technologique pour raconter des histoires ».
 Son style, empreint de poésie, d’humour et de charme, séduit les équipes de Google depuis bientôt quatre ans. Son credo : toucher les gens. « J’essaie d’exprimer les choses avec sensibilité; de faire réfléchir en restant simple et accessible » affirme-t-elle.
Son style, empreint de poésie, d’humour et de charme, séduit les équipes de Google depuis bientôt quatre ans. Son credo : toucher les gens. « J’essaie d’exprimer les choses avec sensibilité; de faire réfléchir en restant simple et accessible » affirme-t-elle.
Après une école de graphisme (ESAG Penninghen) et d’animation (Gobelins Paris), la dessinatrice n’imaginait pas mettre son talent au service de la star du Web. Pourtant, après un processus d’embauche intense, elle saisit sa chance et devient Doodler. Un travail qui la comble : « je fais de l’art en apprenant chaque jour, en découvrant de nouvelles technologies et en étant polyvalente, un réel plaisir ! ».
Une seule règle : pas de sujet polémique comme les thématiques de politique, de religion ou trop sombres. Pour le reste, c’est carte blanche. « Côté style, je ne me sens pas limitée. Ma contrainte, c’est la taille. J’adore les textures et mes images sont parfois trop lourdes. Les ingénieurs râlent… » explique la designer.
Hélène Leroux est basée à San Francisco avec huit autres doodlers à temps plein. Aidés par des artistes indépendants et des responsables locaux qui fournissent des références culturelles, ils créent près de 500 doodles par an. Seule Française de l’équipe, elle assume sa tendance à traiter les sujets tricolores. « L’anniversaire des Shadocks, Molière… Je me rue dessus ! » s’amuse-t-elle.
 Si certains doodles sont diffusés de manière nationale, d’autres le sont à l’international. Une exposition qui n’impressionne pas l’artiste. « J’approche les sujets comme un travail d’illustration lambda, sans penser aux vues » confie-t-elle avec humilité. Surtout, dit-elle, il ne faut pas se laisser intimider par ce que l’on voit. « Les projets en ligne sont aboutis, mais on passe tous par des questionnements et beaucoup de croquis ratés avant ! » Alors à quand un site qui regrouperait les Doodles manqués ?
Si certains doodles sont diffusés de manière nationale, d’autres le sont à l’international. Une exposition qui n’impressionne pas l’artiste. « J’approche les sujets comme un travail d’illustration lambda, sans penser aux vues » confie-t-elle avec humilité. Surtout, dit-elle, il ne faut pas se laisser intimider par ce que l’on voit. « Les projets en ligne sont aboutis, mais on passe tous par des questionnements et beaucoup de croquis ratés avant ! » Alors à quand un site qui regrouperait les Doodles manqués ?
One65 à San Francisco: les réservations sont ouvertes
C’est assurément le projet gastronomique français de l’année à San Francisco. One65, le très attendu bâtiment du chef Claude Le Tohic dédié à la cuisine française, ouvrira ses portes au public le 16 mai. Les reservations pour les trois restaurants-bars répartis sur six niveaux sont ouvertes.
Attention: ils n’ouvrent pas tous en même temps. Le One65 Bistro and Grill (menu basé sur des produits locaux et de saison) et le One65 Lounge and Bar (appelé Elements) n’accueilleront le public qu’à partir du 24 mai. Tout en haut du bâtiment, le restaurant O’ by Claude Le Tohic, pièce-maitresse de l’ensemble, ne verra le jour que le 6 juin selon le site de One65. Patience, donc. Seule la pâtisserie au rez-de-chaussée sera opérationnelle dès le 16 mai.
Moi Impat: "Quand on s'expatrie, on arrive en pleurant et on part en pleurant"
C’est le 25ème épisode de Moi Impat, le podcast consacré aux histoires de ces “ex-expats”, ceux qui sont rentrés, et comment il l’ont vécu.
Eléonore de Rose, 40 ans et mère de 4 enfants, raconte être revenue en France en 2017 après avoir vécu 5 ans à Madrid, où elle y avait suivi son mari, cadre dans une grande enseigne française. La nouvelle de son retour a été un choc pour elle. “J’ai appris qu’on rentrait alors que j’étais dans la cour de récré le 1er septembre 2015. Cela a été violent”, confesse Eléonore de Rose.
Malgré leurs tentatives de rester en Espagne, la famille devra faire ses valises. “On le dit souvent : on arrive en pleurant et on part en pleurant”. Surtout quand le retour n’est pas aussi simple qu’imaginé. “Paris était devenu “ubérisé”, ça m’a vraiment frappée”, explique la Française tout en expliquant qu’elle a finalement trouvé ces nouvelles manières de faire plutôt intéressantes. Par ailleurs, la mère de famille a dû se “ré-imprégner” de la capitale française et se ré-inventer, mais elle confie que l’écriture s’est imposée comme une sorte de thérapie.
Listen to “Episode 25 : Eléonore de Rose” on Spreaker.
Soirée privée "Champagne & Shopping" avec Ba&sh et French Morning
C’est une exclusivité pour les lectrices de French Morning !
L’équipe Ba&sh vous invite à les rejoindre le mercredi 15 mai à partir de 6:00pm dans leur boutique de l’Upper East Side pour une soirée Champagne & Shopping.
Faites vos emplettes dans un magasin privatisé pour l’occasion tout en bénéficiant de précieux conseils mode de la part de l’équipe Ba&sh.
Vous pourrez profiter de boissons, de quelques gourmandises et d’une réduction de 20% pour vous, vos amis et votre famille !
Les places sont limitées, alors n’attendez-pas : Inscrivez-vous ici
Pourquoi la santé coûte-t-elle si cher aux Etats-Unis ?
Les Américains détiennent le record du monde des dépenses de santé. Selon une étude du Economic Politic Insitute publiée en octobre 2018, les dépenses liées à la santé représentaient 17,2% du PIB (Produit Intérieur Brut) américain en 2017. Il est en moyenne de moins de 10% pour l’ensemble des pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). A titre de comparaison, les Etats-Unis ont dépensé plus de 10.000 dollars en soins médicaux par habitant contre 4.600 dollars pour la France, selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Alors que l’ensemble des postes de santé sont en augmentation depuis 2015, comment les Etats-Unis en sont arrivés là ? Pourquoi le prix du système de santé est-il si élevé, alors que l’espérance de vie est en baisse ? C’est la question bête de la semaine.
Un système fondé sur l’économie de marché
“L’idée générale, c’est que le système de santé américain est basé sur le système de marché”, résume Elisa Chelle, politiste et auteure de “Comprendre la politique de santé aux Etats-Unis”. Le système américain ne possède pas de régime général d’assurance maladie et s’appuie sur un ensemble d’assurances privées. Il existe des assurances publiques (comme Medicare et Medicaid), mais elles couvrent uniquement certaines catégories de personnes. Selon une étude réalisée par US Census Bureau, 67,5% de la population américaine possédait une assurance privée en 2016, la plupart du cas via leur employeur. Lorsque les prix des médicaments ou des visites médicales augmentent, la réponse du marché est d’augmenter les primes d’assurances. Contrairement à toutes les autres nations industrialisées, les Etats-Unis ne disposent d’aucun système centralisé qui permette de freiner l’augmentation des coûts de la médecine.
Un système privé au pouvoir de négociation faible
Aux Etats-Unis, les fournisseurs de santé ont un pouvoir très important, en particulier les assureurs et les géants pharmaceutiques. Regroupés sous forme de lobbies, les laboratoires pharmaceutiques règnent sans régulation. Comme la plupart des hôpitaux et des laboratoires appartiennent à des gros groupes privés, il est très difficile pour le gouvernement de réguler et de négocier les prix des médicaments. “Il ne faut pas oublier que le coût des uns fait le revenu des autres. Le système de santé américain est lucratif, et certains acteurs ne souhaitent en aucun cas négocier une baisse de prix”, rappelle Anne-Laure Beaussier. La santé est la seconde industrie et l’un des deux principaux gisements d’emplois aux Etats-Unis, après l’énergie.
Chargée de recherche au CNRS, la spécialiste a étudié le lien entre les soins de santé et les jeux politiques aux Etats-Unis. L’analyste rappelle : “La France et les Etats-Unis ont des traditions juridiques différentes. Les Américains partent d’une analyse sur le terrain sans logique globale où chaque règle s’établit localement. Il n’y a pas de système de santé clair, car les acteurs sont nombreux et éclatés. Il n’y a pas de règle unique, chaque Etat possède ses propres règles. On assiste donc à un empilement de lois. Au final, c’est très complexe”.
Des études chères et une forte innovation
Aux Etats-Unis, il faut compter près de 80 dollars en moyenne -beaucoup plus dans de grandes villes comme New York-, pour une consultation chez le médecin (contre 25 euros en France) et plus de 4.000 dollars pour une journée de prise en charge à l’hôpital (800 en France). La plupart du temps indépendants, les médecins et les praticiens eux-mêmes doivent souscrire à des assurances. Ces frais se répercutent ensuite sur le prix des consultations. Ils doivent également rembourser les crédits financiers qu’ils ont pris lors de leurs études, réputées pour être onéreuses. La médecine est également un secteur qui possède un très haut niveau scientifique et les chercheurs y affluent. “Les Etats-Unis ont un système de santé qui favorise l’innovation. Cela se traduit par une hausse des coûts de santé”, affirme Elisa Chelle.
Des réformes sociales difficiles à mettre en place
Le chantier de la santé a vu échouer de nombreux hommes et femmes politiques. En 2010, Barack Obama a pourtant réussi à promulguer l'”Affordable Care Act”. Plus connue sous le nom d’Obamacare, cette mesure a permis à des millions de ménages de s’assurer, mais a aussi fait grincé des dents une partie des Américains, qui estiment que c’est une atteinte à leur liberté de choix. “Le modèle libéral américain et le système individualiste priment souvent sur la solidarité. Penser que la liberté est plus importante que la solidarité est encore une idée courante aux USA”, analyse Elisa Chelle. Pourtant, de nombreux Américains soutiennent l’idée d’une politique de santé plus abordable. En sursis depuis l’arrivée au pouvoir des Républicains, la loi symbolique de l’ère Obama résiste toujours aux nombreuses attaques du président américain Donald Trump.
Fred North, le pilote d'hélico français star d'Hollywood
19 000 heures de vol, plus de 200 films à son actif, un record du monde d’altitude en 2002… Le talent et l’expertise du pilote Fred North ne sont plus à prouver. Aujourd’hui, il fait partie du top 5 des “stunt pilotes” que les réalisateurs hollywoodiens s’arrachent. Il a participé à d’innombrables tournages à travers le monde parmi lesquels on retrouve “Fast and Furious : Hobbs & Shaw”, “First Man : le premier homme sur la lune”, “Cinquante nuances plus sombres”, “Tarzan”, “007 Spectre” et “Very Bad Trip 3”.
A l’origine de cette carrière plus qu’impressionnante, un souvenir d’enfance des plus marquants. Né en Afrique de parents français, Fred North y passe les vingt premières années de sa vie. À l’âge de 8 ans, il fait une découverte qui va changer à jamais son existence. “ Un jour, se rappelle-t-il, un hélicoptère de l’armée sénégalaise s’est posé dans un stade à côté de chez moi à St Louis du Sénégal. Je me rappelle que tous les gamins de mon quartier ont couru – moi y compris – pour voir cette étrange machine. À son atterrissage, j’ai été émerveillé par le bruit qu’elle faisait et mon destin était scellé.” Douze ans plus tard, il retourne en France et commence ses cours de pilotage.
Très rapidement, il vole de ses propres ailes et devient pilote professionnel d’hélicoptère. Avant de se spécialiser dans le cinéma, il touche un peu à tout : sauvetage en montagne, ravitaillement des maisons isolées, entretien des réseaux électriques et puis la couverture du Paris-Dakar pour la télévision en 1985. “Lorsque j’ai commencé ce nouveau travail, je me suis fait remarquer par mon style de vol particulier et par les prises de vues que l’on obtenait. On m’a par la suite proposé de couvrir différents rallyes: le rally de Tunisie, Maroc ( Atlas rally) , le Paris-Moscow-Pekin et le Raid Gauloises. ”
Pendant 10 ans, Fred North passe 8 à 9 mois de l’année dans le ciel à filmer des courses de voitures. Mais le rêve de gosse réalisé ne lui suffit plus. Son goût pour l’image va le mener plus loin. “J’ai finalement compris que les télévisions favorisaient le contenu et pas toujours la manière de filmer les événements. Dans le cinéma, c’est une tout autre histoire, on parle d’art.”
Avec le soutien de sa famille et notamment de son épouse Peggy, il déménage à Los Angeles et loue ses services en tant que pilote de cinéma. À l’époque, ce poste n’existait pas en France, seuls les blockbusters américains étaient friands de ce genre de plans aériens.
Riche de plus d’une trentaine d’années d’expérience, le Français bénéficie d’une réputation sans faille dans l’industrie. “J’ai fait un peu plus de 200 films, dont 90% d’américains. Je suis connu pour les séquences d’action et d’extrêmes cascades” avance-t-il. “Je suis aussi le seul à Hollywood à avoir des licences a l’international (USA, Europe, Canada, Japon, Brésil, Maroc, Hong Kong…)”
Pour le quinquagénaire, cette success-story s’explique par un attention sans relâche prêtée aux détails. “Une semaine type de boulot, c’est 5 jours de préparation au bureau et 2 jours de tournage – le tout étalé sur dix mois.” Cette période de préparation peut sembler démesurée mais elle est nécessaire pour éviter toute prise de risques une fois dans le ciel ainsi qu’une perte de temps qui pourrait très vite coûter cher.
“Quand je suis dans mon hélico, je suis très concentré et je pense uniquement à ce que je suis en train de faire. Une erreur et c’est le crash. Tout est une question de calme et de contrôle. Le plus difficile, c’est bien entendu le timing et les obstacles qui nous entourent.”
S’il s’approche de la soixantaine, Fred North n’est pas prêt de ralentir. Il travaille actuellement sur différents tournages, dont “Bad Boys 3” avec Will Smith, “Jumanji the Sequel”, “Godzilla contre King Kong” et le prochain “Fast and Furious”.
De La Rochelle à Katy (Texas), le beau voyage d'un pâtissier français
Arnaud Acaries n’est pas né dans la pâtisserie. Paradoxalement, c’est au Texas que ce Rochelais a découvert l’art des douceurs sucrées. Il ouvre dans quelques jours une patisserie française « Bonjour Café » à Katy.
Cette nouvelle enseigne française offrira à sa clientèle une large palette de gâteaux traditionnels mais aussi des compositions très modernes réalisées par Arnaud Acaries. Ce jeune homme de 31 ans a fait ses classes à l’institut Le Nôtre à Houston avant de devenir le chef pâtissier sous les ordres du chef Bruno Gallou au restaurant La Villa. Avec lui, il apprend comment mettre en assiette, approfondir les goûts ou les saveurs dans une cuisine traditionnelle.
L’arrivée à La Villa d’un nouveau chef, Kevin d’Andrea, va bouleverser ses méthodes. Les nouvelles technologies et les siphons font leur entrée dans l’univers de sa cuisine. « L’introduction à une cuisine moderne m’a permis de me lancer dans des constructions d’entremets avec des nouvelles saveurs. Cela m’a libéré et certainement ouvert de nouveaux horizons », explique Arnaud Acaries.
A dix huit ans, c’était déjà l’envie de nouveaux horizons qui l’avait décidé à quitter La Rochelle en s’enrôlant sur un coup de tête dans l’armée pour trois ans. L’appel du large et l’envie de découvrir le monde l’emmènent à Saint Martin dans les Caraïbes où il rencontre sa femme texane qui arrive à le convaincre de la suivre. « De petits boulots en petits boulots, j’ai découvert la pâtisserie et ce fût comme un déclic. J’ai envie de partager cet art culinaire qui raconte notre histoire. D’une réalisation classique à une création contemporaine, j’offre de l’émotion. Je me suis moi-même découvert », explique-t-il. Sa vision de la restauration le pousse ainsi à se lancer et à devenir son propre patron. « A Houston, il y a la possibilité pour un jeune chef français de se dévoiler. Les Américains ont une grande capacité d’adaptation» souligne t-il.
Le nouvel établissement servira une trentaine de couverts au petit déjeuner et au déjeuner. Outre les éclairs, les tartes et les entremets, la carte proposera deux desserts à l’assiette, c’est-à-dire des gourmandises plus travaillées à base de fruits exotiques ou de pétale de rose. Mais Arnaud Acaries veut aller plus loin en lançant un concept de restauration à domicile salé et sucré. « La créativité dans l’activité traiteur me permettra de m’exprimer au niveau cuisine avec des plats classiques mais avec une toucheexpérimentale et moderne. C’est aussi une manière pour m’exprimer de façon artistique », renchérit ce cuisinier passionné de gastronomie.
Si le succès est au rendez-vous, d’ici cinq ans, Arnaud Acaries envisage d’ouvrir une seconde pâtisserie-salon de thé, mais cette fois-ci à Houston, plus luxueuse et haut de gamme pour une clientèle plus exigeante. D’ici là, et pour rester créatif, le jeune chef pâtissier entend bien continuer à s’éduquer culinairement avec des stages proposés par des grands chefs spécialisés en chocolat, en pâtisseries et en sauces. «Je continuerai à me renouveler et à partir à travers le monde pour apprendre et à découvrir de nouvelles sensations».
La conquête spatiale, accusée du premier Tribunal des générations futures de New York
« Sommes-nous des humains ou des terriens ? », lance François Velin, à la tête d’Ubsek & Rica aux Etats-Unis. Pour répondre à cette question, le magazine qui explore le futur proche à l’heure où l’humanité traverse crises et grands bouleversements technologiques, organise pour la première fois aux Etats-Unis son « tribunal pour les générations futures », lundi 13 mai au Lycée Français de New York.
Sur le banc des accusés : la conquête spatiale. Lors de cette conférence-spectacle qui reproduit les codes d’un procès pendant environ 1h30 en anglais, deux camps s’affronteront « dans l’intérêt des 15-20 ans », précise François Velin : d’un côté, les tenants de l’exploration spatiale et de la recherche d’un ailleurs pour l’humanité, de l’autre, les défenseurs de la Terre qui prônent l’investissement des ressources matérielles et humaines dans la sauvegarde de notre planète-mère.
« Le thème de l’espace est très présent dans notre publication, commente le représentant d’Usbek & Rica outre-Atlantique. C’est un sujet aussi bien économique que sociétal. D’un côté, on voit des personnalités comme Jeff Bezos, Elon Musk ou Richard Branson investir dans la conquête spatiale et par ailleurs, on est baigné dans les questionnements sur le climat, l’avenir de la Terre et les angoisses autour de ça », développe l’organisateur de ce tribunal à la mise en scène millimétrée.
Pour veiller à ce que le débat reste ancré dans la réalité économique « et ne soit pas qu’une conversation philosophique », selon François Velin, Usbek & Rica a misé sur des invités directement impliqués dans le sujet. Le président du jury sera notamment incarné par Jeffrey Kluger, rédacteur en chef du Time et auteur du livre (et du scénario) Apollo 13.
Côté espace, le public trouvera Laetitia Garriott de Cayeux, entrepreneure franco-américaine qui a notamment investi dans SpaceX et dont l’époux Richard Garriott a été l’un des premiers touristes de l’espace. Elle défendra la conquête spatiale aux côtés de Michael Massimino, ancien astronaute de la Nasa.
A la barre côté Terre, Usbek & Rica invite les experts-témoins Daniel Katz, activiste qui a monté l’ONG de surveillance des forêts Rainforest Alliance et Paul Gallay, fondateur de l’organisation de défense des eaux new-yorkaises Riverkeeper. Les membres du jury seront tirés au sort sur place, parmi les quelque 300 spectateurs attendus.
« Je suis assez confiant quant à la capacité de ce format à séduire le public américain, confie François Velin. Avec le tribunal, on propose une forme originale mais le fond reste celui d’une conférence traditionnelle », assure le responsable de la marque aux Etats-Unis, qui compte sur cette première édition américaine pour servir de « vitrine » et séduire les entreprises désireuses de reprendre ce format à leur compte.